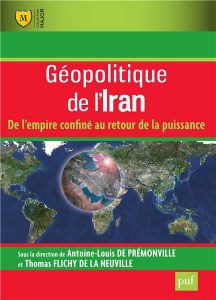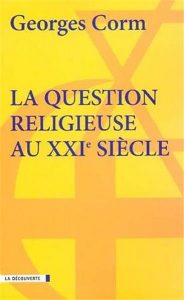Quelles seront les conséquences des accords de normalisation entre Israël et les monarchies arabes pour les Palestiniens et pour la région ? Quels objectifs poursuivent les puissances turque et iranienne dans un Moyen-Orient de plus en plus éclaté ? Que reste-t-il de la dynamique des Frères musulmans ? Analyste et fin observateur du monde arabe et de la géopolitique du Moyen-Orient, Fouad Youssef Nouhra est un enseignant chercheur universitaire libanais. Dans un grand entretien exclusif, il répond aux questions de Mizane.info.
Après Les Emirats arabes unis, Bahreïn vient de signer un accord de normalisation de ses relations avec l’Etat hébreu. A quelle logique politique obéit cette normalisation dans une région où le rapprochement avec Israël est considéré comme contre-nature ?
Le processus de normalisation est assez complexe.
Les raisons pour lesquelles l’Egypte et la Jordanie avaient normalisé leurs relations avec Israël ne sont pas les mêmes que celles des monarchies du Golfe.
La différence se joue sur la centralité de la question palestinienne dans ce processus.
En 1979, au moment où l’Egypte signe les accords de Camp David, nous sommes en période de guerre froide et l’Egypte est irrémédiablement dans le camp américain.
Les Soviétiques s’étaient déjà éloignés de l’Egypte depuis 1972 et il y avait une très forte pression américaine pour un rapprochement et une paix avec Israël.
La stratégie du président Anouar al Sadate était centrée sur ce qu’il considérait être l’intérêt de l’Egypte dans un contexte de déconnexion de l’Egypte de son environnement arabe.
Cette signature qui s’est faite sans l’accord des autres pays arabes et qui ne prévoyait pas de contrepartie pour un Etat palestinien a divisé le monde arabe.

Elle a été d’ailleurs le prélude à une guerre car sans cet accord de paix avec l’Egypte, Israël n’aurait pas eu les moyens d’enclencher une guerre, d’envahir le Liban et de s’attaquer à l’armée syrienne.
La paix a engendré la guerre et c’est un processus de paix/guerre.
La normalisation jordanienne avec Israël était différente.
Les Palestiniens avaient déjà signé des accords de paix avec l’Etat hébreu (accords d’Oslo, traité de Washington, accords de Taba).
La monarchie jordanienne, comme l’ensemble des pays arabes, avait été surprise par la rapidité des accords d’Oslo.
Donc finalement, les Jordaniens se sont dit : « Puisque les Palestiniens ont fait la paix avec Israël, nous pouvons la faire également. »
Cette démarche intervient à un moment où il y a une perspective de compromis israélo-palestinien.
Au moment où la Jordanie signe, la direction de l’OLP, mais aussi beaucoup d’autre acteurs politiques sont persuadés qu’il existe une issue pacifique du conflit, et que le gouvernement travailliste était disposé à rechercher le compromis politique.
L’approche des pays du Golfe a été complètement différente dans la mesure où elle n’a pas pris en compte la question palestinienne et elle intervient au moment où la stratégie israélienne est la plus radicale possible à l’égard des Palestiniens, mais aussi des Arabes en général.
En réalité, il y a eu dans ces monarchies d’autres calculs à prendre en compte puisqu’entretemps ces pays se sont construit un autre ennemi qui est l’Iran et plus précisément l’expansionnisme impérial iranien où ce qui est aussi appelé le croissant chiite.
Dans le calcul des monarchies, la priorité a été d’établir de nouvelles alliances à même de protéger leurs régimes contre de possibles renversements.

Dans cette équation, la question palestinienne n’occupe plus de place importante même s’il aurait été demandé récemment le gel provisoire des implantations de colonies israéliennes dans les territoires occupés en Cisjordanie.
Ce changement de perspective arrive à contre-courant de la déclaration de Riyad de 2002 qui prévoyait une reconnaissance d’Israël en échange d’une restitution des territoires occupés en 1967, de la création d’un Etat palestinien avec comme capitale Jérusalem-est et de la paix avec Israël en conséquence.
Cette déclaration a longtemps fait consensus.
Mais il y a eu un changement de paradigme politique. Beaucoup de pays ont donné la priorité à leur intérêt en tant qu’Etat et mis de côté les objectifs arabes communs.
Historiquement, la menace réelle pour les pays arabes dans la région a toujours été Israël (annexion de la Palestine, bombardements et occupation du Liban, etc). Comment faut-il comprendre dans ces conditions le sens de la normalisation de ces monarchies avec Tel Aviv ?
En fait, ce qui fondait cette perception était le panarabisme et sa logique de solidarité arabe, et à partir du moment où chaque pays a voulu construire sa propre identité nationale, la question palestinienne disparaissait inévitablement, se transformant en une question humanitaire.
Après avoir signé les accords de Camp David, Anouar al Sadate avait troqué la rhétorique panarabe de Gamal ‘Abdel-Nasser en une rhétorique nationaliste égyptienne sur le mode : « Nous avons repris le Sinaï, nous allons maintenant reconstruire l’Egypte. »
En 1970, la médiation américaine avaient proposé à Nasser la restitution du Sinaï contre un accord de paix avec Israël.
Gamal Abdel Nasser considérait que Jérusalem était plus chère à lui que le Sinaï et que le retrait devait être fait de tous les territoires arabes.

Il avait à l’esprit l’intérêt de l’ensemble du monde arabe.
La rupture entre ces deux visions est bien identifiée et elle se voit dans chaque pays arabe.
Cela signifie que même dans cette vision purement nationale de leurs intérêts, les pays arabes ne considèrent pas Israël comme une menace pour eux à moyen ou long terme, alors même que le gouvernement actuel, allié à l’extrême droite israélienne, défend la vision d’un sionisme politique expansionniste ?
Cette vision d’un Israël sécurisant ses frontières est le produit des analystes stratégiques américaines et européennes.
Il ne faut pas oublier que plusieurs dirigeants arabes ont fait une partie de leurs études dans des pays et des instituts anglo-saxons et qu’ils lisent attentivement les études qui en sortent.
Ces études présentent les pays arabes comme étant offensifs et Israël comme un Etat à la stratégie purement défensive.
Penser qu’Israël ne vise qu’à sécuriser ses frontières, c’est ne pas prendre en compte les idéologies radicales dominantes actuellement ; notamment celle de la droite israélienne au pouvoir qui a une conception théologico-historique extensible des frontières du Grand Israël.
De nombreux discours politico-religieux ont été adressé dans ce sens aux forces armées par des aumôniers et des idéologues.
Imaginons ce qui se serait passé après 1982, si suite à son invasion du Liban, Israël avait n’avait pas été contrainte à se retirer par la résistance libanaise.
Nous pouvons conjecturer que le sud-Liban aurait été décrété partie du Grand Israël et qu’il y aurait eu une colonisation de peuplement, comme au Golan, suivie d’une reconnaissance par la droite évangélique américaine et peut être d’un « décret » de reconnaissance du président Donald Trump.
Nous aurions eu une extension territoriale légitimée idéologiquement.
La représentation psychologique est donc le principal facteur politique au Moyen-Orient ?
Tout est question de perception dans le monde de l’action politique.
Anouar el Sadate avait la perception illusoire que l’Egypte allait se redresser économiquement après l’accord de paix avec Israël et devenir plus puissante économiquement que l’Allemagne de l’Ouest !
Ces perceptions sont le produit de la communication des autres Etats, de leurs discours, et de la manière dont ces discours sont relayés médiatiquement.
La presse arabe, à quelques exceptions près, ignore les déclarations anti-arabes très violentes par les dirigeants des partis de la coalition de droite en Israël, et notamment par Avigdor Liberman, Naftali Benett et d’autres, notamment au sujet du transfert forcé des populations arabes.
De la même manière, les discours triomphalistes de certains dirigeants iraniens en 2015, même de ceux qui ne sont pas directement au centre du pouvoir, dont le député Ali Reza Zakani, ont amplifié le sentiment d’insécurité parmi les dirigeant des pays du Golfe, et induit une perception de menace.
Donc tout dépend de la manière dont l’information est relayée, transmise et reçue.
Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui dans les perceptions politiques des pays arabes ?
D’abord le contexte : lors de la guerre israélo-libanaise de juillet 2006, il y avait un soutien arabe aux Libanais.
Les dirigeants qui ne soutenaient pas le Liban ne le faisait pas savoir car les opinions publiques arabes étaient fortement mobilisées en faveur de la société libanaise et de la résistance libanaise, quel que soit leur opinion au sujet des orientations des forces politiques et notamment du Hezbollah.
Aujourd’hui, le contexte a changé puisque nous avons eu entretemps les printemps arabes, la guerre civile syrienne, les confits en Irak et la guerre au Yémen.
L’obsession des pays du Golfe, c’est aujourd’hui la guerre du Yémen.
La perception des monarchies est aussi influencée par certains opposants syriens qui ont présenté la guerre civile syrienne comme une guerre confessionnelle entre sunnites et chiites.
De nombreux dirigeants de courants dits « salafistes » ont tenté de les convaincre de l’existence d’une menace de domination chiite iranienne et on faisait valoir à titre d’exemple le nombre de morts en Syrie.
Il y a une perception déformée (misperception) consistant à présenter les conflits du Croissant Fertile comme des conflits interconfessionnels, alors que la réalité est différente et bien plus complexe.
Cette perception est-elle spontanée ou est-elle alimentée par des acteurs politiques qui auraient intérêt à bâtir une géopolitique de la peur ?
Les deux en fait. Les diplomates et think tanks américains sont très actifs en ce domaine.
Quand des officiels arabes se rendent aux Etats-Unis, il y a un discours qu’ils entendent avec une batterie d’arguments.
J’ai lu peu d’ouvrages américains sur ces sujets qui aient réussi à avoir une vision équilibrée du conflit israélo-arabe.
La légitimité du projet israélien apparaît souvent comme une donnée indiscutable dans la plupart d’entre eux.
La pensée se développe dans une ambiance donnée avec des présupposés donnés.

La perception par les dirigeants du Golfe de leur environnement géostratégique est celle d’une double menace :
Celle représentée par l’Iran et le « croissant chiite » d’une part, et celle représentée par les Frères musulmans et qui induit une méfiance envers le Qatar et la Turquie.
En résumé, tout ce qui remet en cause l’ordre établi représente une menace.
Avant de nous pencher sur les Frères musulmans, revenons un instant sur l’Iran. Les monarchies arabes brandissent fréquemment la menace de l’Iran pour justifier leurs politiques. L’Iran est-elle réellement une menace géopolitique pour ces pays ou est-ce seulement de la rhétorique ?
L’Iran est aujourd’hui sur la défensive.
Le monde arabe après les soulèvements se retrouvait dans la situation d’une zone géostratégique « dépressionnaire ».
Il y a eu un effondrement stratégique de ce qu’on appelle bilad ash-sham et plus globalement du monde arabe, qui a alimenté les ambitions stratégiques de la France, des Etats-Unis, de la Turquie, de l’Iran et qui a renforcé la capacité israélienne.
Cette prolifération des ambitions nationales avait été encouragée par le renoncement de l’administration Obama à imposer un projet américain pour le Moyen-Orient.
Au moment des printemps arabes, la France et la Turquie, alliés dans le même processus, se faisaient concurrence pour savoir qui serait le meilleur allié des futurs gouvernements issus de ces soulèvements populaires.
Lorsque la France a rétropédalé sur le conflit syrien et s’est mise en retrait, la Turquie a maintenu sa position de soutien à l’opposition syrienne ce qui l’a conduite à une impasse.
L’Iran avait ses propres alliés dans le gouvernement syrien et irakien et a soutenu ces derniers grâce à sa capacité de projection de forces asymétriques, ce qui a été perçu par les pays du Golfe comme la preuve d’un projet d’expansion iranien-chiite.
Le moment décisif a été la prise de pouvoir au Yémen par les Ansaroullah (dénommés Houthis).
Il faut savoir que la diplomatie saoudienne dans les années 70/80 n’a jamais été une diplomatie offensive.
Les choses ont changé en 2015 au moment de la guerre au Yémen qui a conduit l’Arabie saoudite à un engagement armé avec les conséquences humanitaires terribles que l’on connait.
Quelles sont les causes de l’engagement armé saoudien au Yémen ? Vous parliez de la perception de l’Iran comme une menace. Les Saoudiens craignent-ils que le Yémen, qu’ils considèrent comme leur arrière-cour, passe sous le contrôle de l’Iran ?
Il faut savoir qu’en 2014, lorsque l’armée régulière irakienne s’effondre, ce sont les brigades d’Al Quds iraniennes qui ont bloqué l’entrée de Daesh à Baghdad.
Même chose en Syrie, mais là avec deux perceptions opposées :
Ceux qui considèrent que : sans l’intervention des Russes et des Iraniens, nous aurions eu une nébuleuse de groupes extrémistes sur le territoire syrien dans un contexte d’affaiblissement des modérés syriens.
Nous aurions eu également un risque de contagion au Liban.
Et ceux qui considère cette intervention comme étant responsable de la destruction des villes syriennes et de l’anéantissement des perspectives de transition démocratique.
En Egypte, par exemple, certains parlementaires envisagent d’intenter un procès contre le Qatar pour soutien au terrorisme.
En Irak, l’ancien premier ministre Nouri Al Maliki avait appeler à la mise sous tutelle de l’Arabie saoudite.
Les monarchies arabes sont des régimes fragiles qui ont toujours besoin soit d’une grande stabilité nationale, soit d’un appui étranger fort : le pouvoir saoudien faisait face à des oppositions de plus en plus actives, tandis que les Emirats arabes unis ont une population à 80 % étrangère et Bahreïn a fait face à une révolution dès 2011, et le régime y doit sa stabilité à l’intervention saoudienne.
Cet équilibre dépend du soutien américain pour Riyad et ce soutien explique aussi l’engagement diplomatique saoudien contre Téhéran.
Voulez-vous dire que les monarchies arabes n’existent aujourd’hui que grâce au soutien américain ?
Non, pas dans ce sens-là. Dès 2013, les stratèges américains avaient émis l’hypothèse d’une fragmentation de l’Arabie saoudite.
Lorsque vous avez des régimes prospères économiquement, mais qui reposent sur un fort besoin de stabilité et dont 90 % de la population est étrangère, cela pose un problème.
A titre de comparaison, les économies iranienne et turque sont moins prospère mais beaucoup plus résilientes.
Dans cette équation géopolitique complexe, que pouvez-vous nous dire des Frères musulmans ?
Aujourd’hui, la dynamique des Frères musulmans est très affaiblie en Egypte, par une répression systématique, cannibalisée en Syrie, par des forces plus radicales, ou amenée au compromis comme en Tunisie.
Leur élimination est internationalement permise et le discours international sur les droits de l’homme ne vaut pas pour eux.
Mais il y a encore le grand frère turc, avec le soutien d’Erdogan aux Frères musulmans. Le président turc recevait récemment le leader du Hamas Ismaïl Haniyeh…
Oui, mais la Turquie est dans une stratégie complètement différente.
Il faut se souvenir que le projet initial de la Turquie était d’intégrer l’Union européenne.
Et les deux premiers mandats AKP ont non seulement engagé toutes les réformes nécessaires, mais adopté le profil le plus conciliant possible.
Face à l’impasse et au refus des pays européens, la Turquie a décidé de se constituer sa propre sphère d’influence dans les pays arabes, avant les printemps arabes, avec la doctrine Davutoglu.
Cette stratégie a échoué avec le coup d’Etat en Egypte qui a destitué le président Morsi (Frère musulman, ndlr) et qui a davantage isolé la Turquie.
A l’heure actuelle, la Turquie cherche à riposter au projet d’un Moyen-Orient éclaté en une fragmentation de micro-états ethniques qui implique la création d’un grand Kurdistan.
Qui défend ce projet de fragmentation politique du Moyen-Orient ?
Il y a eu un soutien maximal des pays de l’alliance atlantique, en particulier des Etats-Unis et des Européens envers les milices kurdes syriennes, elles-mêmes proches du PKK qui veut faire sécession en Turquie.
Si les Kurdes syriens réussissent à créer un proto-Etat au nord-est syrien avec la protection militaire américaine, cela va entraîner immédiatement une intensification de la révolte armée kurde en Turquie, puis la sécession des régions à majorité kurde.
On lit parfois que des Etats comme Israël soutiennent une stratégie de balkanisation du Moyen-Orient pour affaiblir leurs ennemis politiques. Sommes-nous dans ce cas de figure ?
C’est plus complexe que cela.
La balkanisation du Moyen-Orient commence dès 1922 en Syrie avec la création d’un Grand Liban sous domination chrétienne ainsi que d’un état alaouite et d’un état druze.
Cette idée qui avait en partie échoué à l’époque avec la décolonisation a été reprise par le Congrès américain en 2006 pour ce qui concerne l’Irak, sur évocation des propositions de Bernard Lewis et Ralph Peter.
L’idée était de dire : isolons les sunnites qui nous combattent, créons un Etat chiite, créons un Etat pour les Kurdes qui sont nos alliés et tout le reste du Moyen-Orient se morcellera sur ces bases.
10 ans plus tard, nous avons un autre acteur, Daesh, qui a été un facteur d’accélération de ce morcellement, avec sa politique d’élimination de tout ce qui est différent et hétérogène.
Un autre acteur essentiel sont les milices kurdes syriennes qui sont perçues par Ankara comme un facteur de décomposition de la Turquie.
Il y également une dimension géostratégique régionale importante pour la Turquie qui a des intérêts pétroliers et gaziers en méditerranée orientale, avec le nord de la Chypre.
Le coup d’état raté de 2016 a aussi été identifié par les Turcs comme une étape d’un projet plus global.

Certains commentaires en Turquie soupçonnent la base de l’OTAN à Incirlik d’avoir soutenu les acteurs du coup d’Etat.
Il y a aussi la non condamnation par l’Union européenne de ce coup d‘état.
Actuellement, la Turquie n’a pas de projet régional « néo-ottoman » et se trouve dans une posture réactive du « tit for tat ».
Les Turcs ont tout de même projeté des forces d’interventions en Libye, à l’instar de la Russie et de la Syrie qui ont envoyé des mercenaires sur place, ce qui est une politique offensive. Pour quelles raisons l’ont-ils fait ?
C’est en effet une politique offensive mais qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un projet idéologique.
La scène arabe est perçue par les Turcs comme une scène d’épuration politique des forces d’opposition : le président Erdogan fait implicitement le parallèle entre les régimes militaires arabes qui ont liquidé les opposants issus du Printemps arabe et les militaires turcs qui ont essayé de liquider l’AKP.
Il y a également, derrière cette intervention turque, la protection de l’accord économique de partage des zones maritimes entre la Turquie et la Libye, qui permet à la Turquie de contourner la Grèce et Chypre. Il y a donc aussi un objectif stratégique.
L’Iran n’est-elle pas le grand vainqueur dans la région grâce au contrôle ou à l’influence politique qu’elle exerce sur l’Irak, le sud-Liban et le gouvernement d’Assad ?
Il y a cinq ans, cela était encore possible mais plus aujourd’hui.
L’Iran est encerclée, subit les sanctions économiques américaine et voit certains de ses alliés s’en détacher.
Il faut savoir que le système politique iranien est bicéphale.

Vous avez le président de la République et vous avez le Guide suprême.
Vous avez des acteurs politiques aux objectifs différents, aux discours différents.
Tous les acteurs politiques de la scène iranienne ne sont pas d’accord avec les décisions qui sont prises par l’une des deux têtes.
Il y a eu par exemple un désaccord entre les plus radicaux et les plus modérés sur l’accord du nucléaire : aujourd’hui les premiers reprochent aux derniers de l’avoir signé et d’avoir fait confiance aux puissances européennes et américaine.
De la même manière, lorsque le président Ahmadinejad a soutenu le Liban durant son premier mandat, il y a eu des critiques internes.
Le candidat Moussaoui (opposition) lui a reproché de dépenser l’argent du peuple iranien au Liban, en Syrie et en Palestine.
Cet aspect multiforme de la scène politique iranienne fait que chaque acteur est capable d’avancer ses pions et met les autres devant le fait accompli, ce qui met souvent le pays en difficulté.
L’Iran a constitué un réseau d’alliances régionales.
Mais en Irak, son allié ce sont les forces politiques religieuses chiites appuyées par des constellations de milices et de forces populaires.

Ces milices sont de plus en plus contestées sur le terrain par les Irakiens, y compris chiites, ce qui explique les mouvements de révoltes qui ont eu lieu depuis 2018 et 2019 de manière continue et qui ont été réprimés par ces milices.
Aujourd’hui, il y a des revendications qui sont davantage économiques et sociales de lutte contre la corruption, sachant que le peuple irakien a déjà perdu plus de 700 milliards de dollars à cause de la corruption.
Donc les réseaux d’alliance qui ont été constitués autour des partis religieux sont perdants actuellement.
L’objectif des puissances opposées à l’Iran est de récupérer l’Irak à travers un projet de reconstruction du pays et de désarmement des milices.
En Syrie, le gouvernement a re-conquis la plupart des territoires de l’opposition, mais il y a beaucoup d’inconnues.
La reconstruction du pays a besoin d’argent et ce sont davantage les pays du Golfe qui en ont les moyens.
La Syrie est alliée de la Russie et l’Iran mais ces deux pays n’ont pas les mêmes objectifs.
Il faut savoir que lorsque l’aviation israélienne bombarde les positions iraniennes en Syrie, le gouvernement israélienne informe au préalable les autorités russes.
Vous avez deux alliés dans le conflit syrien qui ne sont pas alliés dans le conflit israélo-arabe.
La normalisation israélienne avec les monarchies du Golfe aura pour conséquence d’affaiblir davantage le Liban.
Le Liban, depuis la guerre civile en Syrie, est demeuré le pays le plus solide géostratégiquement, mais sa fragilité réside dans sa structure politique de système confessionnel, et dans son économie sans réel fondement productif.
A présent, l’offensive contre le Liban est économique avec un couplage entre des sanctions américaines, les dérives de la banque centrale libanaise, et les obstructions d’acteurs politiques internes.
Si une guerre civile éclate à cause de la situation économique, tous les verrous stratégiques du monde arabe seront tombés.
Quelles seront les conséquences de cette normalisation israélienne avec les monarchies arabes pour les Palestiniens ?
Il y a actuellement une tentative pour faire émerger une direction palestinienne plus pragmatique qui acceptera plus facilement les propositions liées au « Deal du siècle », avec de moins en moins de territoires, une Cisjordanie réduite à des enclaves à faible importance stratégique , et face à un Etat qui affirme officiellement l’inégalité entre les communautés.
Les Palestiniens sont les grands perdants de cette équation.
Sans contrepoids politique, la question palestinienne se réduira à une question humanitaire.

L’axe Egypte-Arabie saoudite est favorable à une normalisation avec Israël, avant même que la question palestinienne ne soit résolue.
Aujourd’hui ce sont la Turquie et l’Iran deux puissances non arabes, qui s’érigent en défenseur de l’intégrité des territoires palestiniens et de la souveraineté arabe sur Jérusalem Est.
Voici le paradoxe, une cause arabe défendue en priorité par deux puissances non-arabes dont les relations avec les gouvernements des Etats arabes pivots s’est détériorée.
L’islam politique a-t-il finalement remplacé le panarabisme dans le ferment du soutien à la cause palestinienne ?
Le paradigme panislamique est un paradigme idéologique, qui s’écarte de la réalité socio-politique de la région.
La Turquie n’a pas abandonné le nationalisme turc et les décisionnels iraniens continuent à se référer à l’identité perse.
L’AKP ne défend pas de vision panislamique.
Il y a un nationalisme turc en Turquie tout comme il y a un nationalisme persan en Iran.
L’Egypte est aussi un pays musulman.
Sissi est l’un des militaires les plus pieux qu’il y ait eu en Egypte.
Il existe plusieurs variantes et dimensions de l’islam politique : celui du gouvernement égyptien consiste à ancrer le système juridique dans ses racines historico-religieuses, tandis que celui que l’on retrouve dans l’AKP est une forme de discours de solidarité avec les populations musulmanes opprimées (Palestine, Birmanie, etc..), le fameux concept de « madhloumiya », et celui des Frères musulmans est l’utopie d’une communauté transnationale.
Vous avez tout de même des régimes laïques comme ceux des partis Baas (ex-Irak, actuelle Syrie) qui se distinguent dans leur référentiel politique de celui de l’Iran et de l’AKP (Turquie), des pays où l’islam joue un rôle plus important dans l’identité politique…
Actuellement, la Turquie est toujours une république laïque tandis qu’en Egypte l’Islam est religion d’Etat et la Shari’a source de législation.
L’AKP n’a pas renoncé à la laïcité.
Lorsqu’Erdogan premier ministre s’est rendu en Egypte en 2012, à l’époque où les Frères musulmans étaient au gouvernement, il leur a conseillé de créer un état laïc.
L’AKP, en dépit de la rhétorique religieuse utilisée à certains moments par son président, n’a pas remis en question le fondement laïc de l’identité turque mais prône une laïcité compatible avec les pratiques religieuses et leur visibilité sociale.
La monarchie saoudienne se définit comme islamique tout comme le régime iranien.
La Turquie se définit encore comme une République laïque.
Il faut éviter de tomber dans le piège des discours apparents et des échos journalistiques.
A lire également :