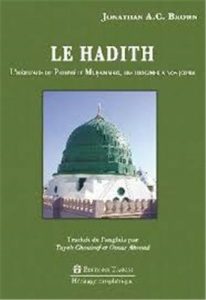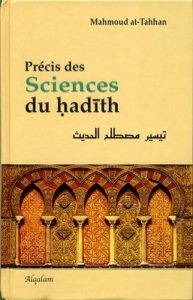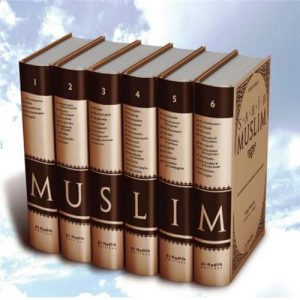Suite de la série d’articles du professeur Jonathan Brown extraits d’un texte consacré à l’étude du hadith. Quelles étaient les notions de certitude et de probabilité adoptées par les savants du hadith ? Jonathan Brown, auteur du livre « Le Hadith : l’héritage du prophète Muhammad des origines à nos jours » (Tasnim), nous fournit quelques éléments de réponse dans cette publication de Mizane.info.
Avant l’absorption de la pensée mu’tazilite dans la théorie juridique sunnite à la fin du quatrième / dixième siècle, le langage de l’épistémologie islamique parmi les partisans du hadith était encore enraciné dans le vocabulaire coranique et dans les premiers usages évidents de la littérature du hadith. ‘Ilm (connaissance) et yaqin (certitude) désignaient à la fois la connaissance religieuse révélée et une certitude cosmique de la foi. Le Coran avertit les gens de ne pas « suivre ce dont vous n’avez aucune connaissance (‘ilm) » (Q 17:36). Le Livre saint décrit le message du Prophète comme « la vérité certaine (al haqq al-yaqin ) » (Q 69:51), interpellant ceux qui l’entendent en ces termes : « Si vous le saviez avec une connaissance empreinte de certitude (‘ilm al-yaqin), vous verriez le Feu flamboyant » (Q 102: 5-6).
Les hadiths emploient le terme yaqin pour désigner la certitude de la foi, avec une tradition rare attribuée au Prophète déclarant : « Je ne crains rien pour ma communauté sauf la faiblesse de la certitude (yaqin). » Ibn al-Muhayrîz (mort en 720) affirme une distinction entre « ‘ilm en tant qu’une certaine connaissance contenue dans le Coran, et fiqh en tant qu’investigation humaine faillible de la loi de Dieu. » Le mot zann, plus tard employé par les théoriciens du droit comme connaissance probabiliste suffisante et comme preuve utilisable en droit et pour le rite, était plus ambigu. Dans le Coran et les premiers hadiths, zann pouvait avoir le sens neutre d ‘«opinion» ou de «supposition», ou la connotation négative de spéculation sans fondement en l’absence de véritable connaissance. Quand les non croyants prétendent qu’il n’y a que cette vie terrestre, le Coran objecte qu’ « ils n’en ont aucune connaissance (‘ ilm) ; ils ne font que spéculer (yazunnun) » (Q 45:24),
Dans les hadiths, zann peut signifier simplement « pensée », comme le hadith qudsi (sacré, divin) disant: «Je suis avec la pensée (zann) de Mon serviteur quand il pense à Moi», mais cela peut aussi être associé au jugement des autres. Un hadith déclare « Méfiez-vous du zann (ici « spéculation sur les autres »), car le zann est le discours le plus faux. » Cet usage du terme zann était répandu aussi tard qu’au quatrième / dixième siècle parmi les savants du hadith.
Le juriste hanafi et spécialiste des hadiths Abu Ja ‘far al-Tahâwi (décédé 321/933) explique : « Quiconque transmet un hadith du Messager de Dieu à partir du zann (bi-l-zann), c’est comme s’il transmettait de lui à partir d’autre chose que la vérité (haqq); et quiconque transmet des hadiths à partir de quelque chose d’autre que la vérité transmet quelque chose de faux ( ou vain, batil) ».
Comme l’explique le juriste shâfi’ite et théoricien juridique influent Abu Sulaymân Hamd al-Khattâbi (décédé en 388/998) dans son commentaire d’un hadith utilisant le mot zann : Zann est à une extrémité de la supposition du spectre (husban) et à l’autre extrémité se trouvent la connaissance (‘ilm) et la certitude (yaqin). Les Arabes emploient le mot zann une fois dans le sens de supposition et une autre fois dans celui de la connaissance et de la certitude en raison des deux extrémités sémantiques de ce terme. Ainsi, le début de la connaissance est zann et son étendue la plus éloignée est la certitude. »
Les ouvrages historiques de théorie juridique sunnite du cinquième et du dix-neuvième siècle soutenaient à ce propos que les hadiths ahad ne produisaient que des connaissances probables, suffisantes pour le droit, mais pas la certitude (‘ilm) requise pour la discussion théologique.
Al-Khatib al-Baghdâdï (d. 463/1071) expliquait succinctement cette position : les hadiths ahad ne peuvent être acceptés sur des questions de théologie car « si l’on ne sait pas avec certitude (ya’lam) qu’il s’agit d’une parole du Messager de Dieu, on est encore moins sûr de la signification de son contenu. Mais en ce qui concerne les questions de droit qui n’exigent pas que nous sachions avec ce degré de certitude, « cela est convaincant pour les musulmans ».
Beaucoup de ces théoriciens du droit ont également noté que certains des premiers partisans du hadith avaient affirmé que les hadiths ahad produisaient une certitude épistémologique. Cette position des premiers partisans du hadith n’était pas une position minoritaire. Si nous considérons les juristes les plus éminents du troisième / neuvième siècle et les savants qui ont rédigé les grands recueils de hadiths du canon sunnite, nous constatons que beaucoup ont épousé cette opinion rejetée par les théoriciens ultérieurs du droit. Pour ces premiers sunnites, les hadiths ahad fiables constituaient un véritable récit du message du Prophète et une base solide pour les principes théologiques.
Quand al-Tirmidhî présente un hadith décrivant comment Dieu prendra les dons de bienfaisance des gens « de sa main droite », il explique : « Plus d’un savant a dit que ce hadith et d’autres récits similaires traitant des attributs de Dieu et de la descente du Seigneur le Très-Haut chaque nuit vers les cieux les plus bas ont été établis et doivent être crus. Ils disent qu’il ne faut pas se tromper à leur sujet et dire « Comment cela pourrait-il être? » Il a été rapporté que Malik b. Anas, Sufyan b. ‘Uyayna, et Abdallah b. Al-Moubarak ont tous dit à propos de ces hadiths : « Prenez-les tels quels sans demander comment. » Telle est la position des premiers savants sunnites.
Les paroles d’Al-Tirmidhi laissent peu de doute sur le fait que, dans son esprit, le fait que ces hadiths théologiques aient été « établis » (thabata) comme étant du Prophète signifiaient qu’ils devaient être crus. Ibn Hanbal a publié une déclaration similaire sur les hadiths décrivant comment les croyants verraient Dieu au Jour du Jugement : « Nous croyons en eux {nu’minu biha) et savons qu’ils sont la vérité (haqq). »
Al-Shâfi’î avait aussi fait une déclaration similaire en matière juridique. Dans le chapitre du livre Kitab al-Umm à propos de ses désaccords avec son professeur Malik b. Anas (décédé 179/795), al-Shafi’i explique : « Si une personne fiable raconte à partir d’une personne fiable jusqu’à ce que [le rapport] aboutisse au Messager de Dieu, alors le hadith est établi comme étant du Messager de Dieu. » Abu Bakr Ibn al-Mundhir (d. 319/931) commence fréquemment des chapitres sur des questions juridiques dans son recueil sur le consensus juridique et le désaccord en désignant les paroles du Prophète comme ce qui avait été « établi » (thabata, thabit) : « Il est établi que le Messager de Dieu a dit : « Si une mouche atterrit dans votre boisson, poussez-la entièrement sous la surface et ensuite enlevez-la, car s’il y a du poison sur l’une de ses ailes, dans l’autre se trouve le remède. » »
Fait intéressant, nous savons que les premiers partisans du Hadith ont conçu différents niveaux de connaissance. Bien qu’à première vue cette gradation épistémique semble anticiper l’épistémologie ultérieure des théoriciens du droit, sa fonction première était polémique. Les savants du hadith défendaient l’utilisation des hadiths dans l’interprétation religieuse contre les rationalistes qui pour leur part refusaient de prendre en considération toute preuve qui n’était pas historiquement aussi fiable que le Coran. Les savants du hadith comme al-Bukhari ont utilisé les hadiths ahad comme une forme de preuve unique et suffisante dans les chapitres de leurs recueils de hadiths qui traitaient des positions théologiques sunnites telles que la vision des croyants de Dieu à la résurrection ou de Dieu parlant littéralement aux prophètes le jour du jugement, les jugeant dignes de confiance.
De la manière dont ils sont décrits dans la littérature polémique sunnite, certains rationalistes seraient allés jusqu’à affirmer que tout hadith dont la véracité n’était pas connue avec une certitude apodictique devrait être classé comme faux. La dépendance aux hadiths en théologie était jugée ridicule aux yeux des rationalistes. La seule concession que les polémistes, parmi les partisans du hadith, espéraient de manière réaliste tirer des rationalistes était que les hadiths ahad étaient à la fois essentiels et convaincants dans l’élaboration de la loi islamique, position jugée digne et nécessaire aussi bien par les rationalistes que par les partisans du hadith.
Dans sa discussion des principes juridiques, al-Bukhâri consacre une section sur la façon dont les compagnons dépendaient des récits prophétiques des uns et des autres pour obtenir une image complète de la loi de Dieu. Commentant le travail d’al-Bukhârî au cinquième / onzième siècle, Ibn Battal (décédé 449/1057) de Cordoue a expliqué que « cette section réfute une opinion shiite et khâridjite prétendant que les décisions et la Sunna du Prophète ont tous été transmis de lui par une transmission massive (tawatur) et qu’il n’est pas acceptable d’utiliser quoi que ce soit qui n’ait pas été communiqué de cette manière. »
Montrer que la Sunna était principalement composée de hadiths à transmission limitée (ahad) était pour des savants sunnites comme Ibn Battal une étape cruciale pour mieux saper d’autres revendications de groupes religieux exigeant une loi islamique qui soit plus sûre. La différence la plus marquante entre la gradation épistémique élaborée par les premiers partisans du hadith et celle des théoriciens du droit sunnites ultérieurs était son but.
Dans le cas de l’épistémologie la plus développée, celle d’al-Shâfi’ï, nous constatons que sa division fondamentale de la connaissance religieuse reflétait d’abord et avant tout celle de son public cible, qui n’informait que sur un plan secondaire sur le degré de sa certitude.
La « connaissance des masses » (Him al-‘amma) était cette information dont la connaissance incombait à la généralité des musulmans et était également transmise de génération en génération par la communauté dans son ensemble, comme l’obligation de prier cinq fois par jour. Le deuxième type de connaissance était la « Connaissance des élites » (‘ilm al-khassa), qui consistait en des questions de droit religieux sur lesquelles aucun texte coranique explicite n’existait et qui était donc soumise à la délibération des savants. Parallèlement à ces deux niveaux de connaissance, al-Shâfi’î mentionne deux niveaux d’accompagnement : « l’information des masses » (akhbar al-‘amma) et « l’information des élites » (akhbar al-khassa). Ces dernières étaient sujettes à interprétation au-delà de leur signification évidente (ta’wil) et pouvaient être interprétés à la lumière d’un raisonnement analogique. Les informations des masses n’ont cependant pas fait l’objet de controverses, d’interprétations (ta’wil) ou d’erreurs à propos de leurs transmissions.
Bien qu’il y ait des similitudes frappantes avec la dernière dichotomie ahad / mutawatir de la théorie juridique sunnite, la caractéristique la plus saillante de ces deux catégories dans le travail d’al-Shafi’i n’est pas leur fiabilité mais plutôt la nature des devoirs qu’elles décrivent et le public auquel elles s’adressent – dimensions absentes des distinctions des théoriciens du droit ultérieur.
De plus, l’incertitude inhérente aux informations des élites, comme le discours de la Connaissance, traduit davantage une ambiguïté d’ordre interprétative qu’une incertitude historique. Ce qui ressemble étroitement au contraste ultérieur entre la probabilité et la certitude qui résulte de ses rencontres face à des rationalistes musulmans tels qu’Ibrahim ibn Ulayya (d. 218/833).
Dans sa Risala, al-Shafi’i explique qu’il existe différentes sortes de connaissances, y compris « une connaissance approfondie des aspects prima facie et ultimes » (ihatafl l-zahir wa- l-batin) d’une chose, par opposition à sa simple « vérité prima facie » (haqq fil-zahir).
La première consiste en des questions sur lesquelles le Coran ou la Sunna ont donné des réponses claires et qui ont été transmises par la masse, génération après génération. Ce sont des sujets que tous les musulmans doivent connaître et « sur lesquels il peut être juré que ce qui a été déclaré permis par eux est permis et ce qui a été interdit par eux est interdit. »
Le second type est identique à la connaissance des élites, connu uniquement par des hadiths limités transmis par les savants du Prophète et qui leur incombent seulement de savoir.
Dans son débat avec les rationalistes, al-Shäfi’i répond aux objections des opposants qui rejettent la valeur de preuve des hadiths ahad et leur demande comment pourrait-il présenter des informations émanant « de tel ou tel » avec le même niveau de fiabilité que le Coran. Al-Shâfi’î répond : « Nous n’accordons cette [crédibilité] que dans une perspective de connaissance globale (ihata), à travers les compte-rendu de personnes sincères et l’analogie. » Un opposant le contredit en lui demandant des preuves. « Je n’accepte aucune transmission s’il est possible qu’ils [les émetteurs] se soient trompés, et je n’accepterai rien que je ne puisse jurer au nom de Dieu comme je le jure par Son Livre, dont personne ne peut douter un seul mot. »
Al-Shafi’i lui répondit que son opposant reconnaît à un juge musulman le pouvoir de faire exécuter quelqu’un si deux témoins déclaraient qu’il avait assassiné quelqu’un, même s’il est possible que ces deux témoins aient menti dans leur déposition. C’est, sans aucun doute, une affaire dans laquelle on devrait exiger « une connaissance globale (ihata) », alors en quoi cela diffère-t-il d’accepter des hadiths dans lesquels il y a une possibilité concevable d’erreur ou de mensonge ?
Son adversaire, explique al-Shafi’i, est prêt à prendre la vie de quelqu’un en raison de « l’apparente véracité » (sidq fil-zahir) des témoins, ce qui est exactement ce qu’al-Shâfi’i exige dans la transmission des hadiths. Ici, al-Shafi’i n’admet pas qu’il n’est pas sûr de la véracité de ce qu’il considérerait comme des hadiths ahad fiables. Il explique que le monde dans lequel les humains vivent et opèrent ne peut pas exiger le niveau de certitude que son adversaire prétend exiger. Ce niveau supérieur de certitude n’existe tout simplement pas pour les hommes. « Seul Dieu connaît l’invisible », explique-t-il.
La confiance suprême d’Al-Shafi’i dans la certitude fournie par les dites transmissions est soulignée et détaillée dans sa déclaration qu’un témoin ne peut témoigner que sur la base de ce dont « il a connaissance. » Les connaissances du témoin, précise-t-il, peuvent être de trois types: (1) ce qu’il a vu directement, (2) ce qu’il a entendu directement, et (3) des affaires qui « ont été largement transmises, dont la plupart n’ont pas été réellement témoins mais dont la connaissance est établie dans le cœur. »
Dans cette déclaration, al-Shâfi’i affirme qu’un témoin doit être aussi sûr de son témoignage qu’il l’est de sa perception sensorielle ou de rapports sur des événements survenus dans le passé. Il ne doute pas plus de la certitude d’un tel témoin qu’il ne doute de la perception sensorielle ou de la transmission fiable. L’incapacité du juge à connaître la vérité ultime de la culpabilité ou de l’innocence dans une affaire qu’il juge est représentée dans un dit prophétique cité par les partisans du hadith : « Je ne suis qu’un homme, et il se peut que l’un de vous soit plus éloquent dans la présentation de votre preuve que l’autre. » Une version ultérieure de ce hadith, trouvée uniquement dans le hadith notoirement peu fiable extrait du recueil « Firdaws al-akhbar » de Shirawayh b, Shahrudär al-Daylami (d. 509/1115), incarne la voix éditoriale des partisans du hadith : « Je ne suis qu’un homme, et je ne connais pas l’invisible (ghayb) ». Cela implique que la certitude extérieure que peut atteindre le juge (même le prophète) est la seule certitude que les gens peuvent espérer sans omniscience divine.
Nous trouvons par ailleurs un rejet clair de la notion selon laquelle les hadiths ahad ne donnent pas la certitude requise dans la vie quotidienne chez Ibn Hanbal.
Le théoricien juridique hanbalite de Bagdad, Ibn al-Farra’ (d. 458/1066), cite l’élève de Ibn Hanbal, Abu Bakr al-Marrûdhî (d, 275 / 888-89) disant à son professeur : « Voici quelqu’un qui prétend qu’un hadith est contraignant en droit mais ne donne pas de connaissance (‘ilm). » Ibn Hanbal rejeta cela, s’exclamant « je n’ai aucune idée de ce que c’est » (ma adri ma hadha). Ibn al-Farrâ interprète cela comme signifiant qu’Ibn Hanbal a traité la certitude épistémologique (‘ ilm) et la probabilité juridiquement contraignante de manière identique.
Ici, nous devons aborder une objection potentielle, celle précédemment citée de l’opposant d’Al-Shâfi’î, et soulever une question importante à propos du Coran. Si nous maintenons qu’al-Shâfî’i soutenait que la certitude fournie par des hadiths fiables de type ahad était, en fait, la forme la plus élevée de fiabilité disponible pour un savant, qu’en est-il de la fiabilité du Coran, que les théoriciens du droit sunnites classent comme mutawatir et donc épistémologiquement certain dans son attribution historique au Prophète ?
Ici, nous devons affirmer que les savants du hadith n’ont pas traité le Coran comme étant catégoriquement supérieur sur le plan épistémique aux hadiths fiables. Dans son autorité interprétative, les premiers proto-sunnites et de nombreux savants sunnites ultérieurs ont explicitement subordonné le Coran à la Sunna, qu’ils déclaraient « régner sur le Livre de Dieu » et non l’inverse.
De plus, du point de vue de leur échelle de transmission, les lectures du Coran n’étaient pas toujours acceptées comme canoniques ou authentiques parce qu’elles répondaient aux exigences techniques des théoriciens du droit pour une transmission massive (tawatur) mais simplement parce qu’elles avaient des chaînes de transmission (isnad) largement acceptées.
Pour nos besoins, à moins qu’il ne puisse être prouvé que les savants du hadith traitaient des versets coraniques comme intrinsèquement plus fiable sur le plan historique que des hadiths authentiques, la déclaration des théoriciens du droit du cinquième / onzième siècle selon laquelle le Coran est mutawatir n’a donc aucune incidence sur la vision épistémologique du monde d’al-Shafi’i ou de ses contemporains.
Al-Shâfi’î faisait la distinction entre les forces de la preuve (hujja) fournies par « un texte explicite (nass bayyin) du Livre [de Dieu] ou un précédent prophétique (sunna), dont personne ne peut douter », d’une part, et un hadith « sur lequel le rapport pourrait différer » de l’autre. Mais, encore une fois, la question ici n’est pas une question de fiabilité historique mais plutôt d’explicitation interprétative et de consensus sur le sens d’un texte d’une part, et l’ambiguïté et le désaccord d’autre part.
Jonathan Brown