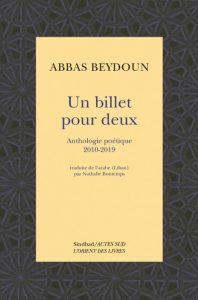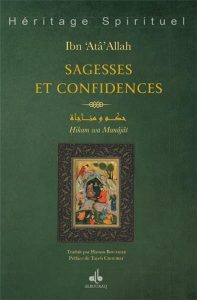Comment apprendre à faire un deuil impossible ? Dans un texte littéraire remarquable que Mizane.info publie, Khadir Ouadah nous livre ses pensées intimes sur un sujet douloureux : la perte des parents. Khadir Ouadah est diplômé en éthique islamique et titulaire de plusieurs masters en droit public et privé, en philosophie du droit et droit politique à l’université Paris II.
« Béni soit Celui qui tient en Ses mains la Royauté, et Il est puissant sur toute chose. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et connaître ainsi celui d’entre vous qui agit le mieux. Et Il est le Tout-Puissant, Il est Celui qui pardonne. » Coran, sourate 67 Al-Mulk (La Royauté), versets 1 et 2.
Demain, maman, ou papa, n’était plus. Introspection tardive de la mort prospective. À l’âge d’enfant, innocent, des larmes inopinées coulaient trop tôt. Elles tombaient, marquaient comme la griffe d’un animal blessé mon visage immaculé – paisible jusqu’alors – avant le souvenir de celle qui n’était point venue encore. La mort, à la vie candide que l’enfant que j’étais menait, avait extirpé, arraché des questions insondables, éveillé quelque tension immaîtrisable. D’où mon esprit accoucha d’une demande bien trop mature – en cela prématurée – que ni mon inachevée carrure ni ma faible stature ne pouvaient supporter. Un accouchement dans le mauvais corps.
Les gens disent « vie », les gens disent « mort » ; avec la tête, je dis « aporie ». Un amour naturel, intemporel, qui cédait pourtant devant la conscience aigüe, fragile, aiguisée jusqu’à l’excès, d’une absence prochaine. Un canif pour conscience, une entaille pour mémoire. « Je suis la plaie et le couteau ! Je suis le soufflet et la joue ! », agonisait Baudelaire. Conscience qui ne peut se fuir elle-même.
Tourment précipité du réel ; du réel en avance. Une intelligence enfantine sous protection, recouverte de jeux et de distractions à foison, peut, lorsqu’elle s’agite, étouffe sous l’amoncellement des couleurs mécaniques, s’avérer imprudente avec la raison, rebelle contre les images. Une pénétration des arcanes de l’affliction. Nu l’enfant né, car protégé nul enfant n’est. Irruption de la réflexion inopportune au monde de l’insouciance adulte.
Dès le souffle de vie, écorché vif. Elle n’est pas partie qu’elle l’est déjà, dans mon esprit, brume de laquelle je tire, blâme le jaillissement de l’avenir. Une mémoire intempestive, d’aucuns songes assassins. Car, comment ne pas le supposer, que toute cette dramaturgie fut préméditée ?
Par hasard, au détournement d’un regard, à la friction de méprises, au croisement de sentiments, j’eus perdu mille paix, gagné autant en ressentiment. Hasard de la formule, dé mathématicien, très doué de calculs.
Ma vie n’a peu grandi, que déjà une vue perçante avait succédé à ma cécité. Oui, la douleur disait quelque chose de mon cœur meurtri. Que, dès cet instant, et jusqu’à la fin des temps, je pleurerai différemment. Apprendre la peine, s’enseigner le sanglot, avant que les pleurs ne nous prennent. Avait coulé, de mes prunelles, une saveur de liqueur qui n’était plus la même. Mes larmes ont vieilli.
Le pilier de la maison, c’est ainsi que l’on te décrit. Mais non, cela jamais ne suffira. Pilier de mon cœur : s’entend mieux, s’entend vite. Parfum de mon âme, armure apparemment légère de mon frêle corps. Une maison vide. Quant à moi, je ne puis faire le serment d’être fort ; simplement d’essayer l’effort. La force, qu’est-ce que la force ? Apprendre à oublier, déjà, le départ inéluctable ? L’éclat du rire, la douceur d’un regard, la tendresse d’une caresse ? Est-ce oublier, se noyer dès à présent dans le rejet éternel d’un décret futur, décidé – en voie de descente – presque arrivé ? Indécent. Parce que d’autres ont pleuré plus que moi, bien avant.
L’être cher manque, et oublier l’absence prochaine – la leur, quant à elle bien réelle – est offense. Il est vrai, néanmoins, qu’aux grands boulevards illuminés du peuple, ma préférence va à la désolation des pièces décimées de tout meuble.
Non, je le refuse. Et qui, lorsque seul j’appellerai, me répondra ? Je scanderai insouciant « maman, maman ! », mais la réalité, ainsi que le silence, percuteront de plein fouet mon existence. Et qui, encore, lorsque le tonnerre tonnera de sa colère, me tiendra la main au bord du lit, pour apaiser mon angoisse ? Et qui, enfin, lorsque je partirai pour longtemps, pleurera mon absence, que je pleure à mon tour ses larmes en silence ? Devant le Très-Haut, privé de tes prières pour ton fils. Sous tes pieds, le paradis que j’ai négligé.
L’impression d’un siècle que je regrette les baisers de la nuit, le pardon, les gronderies. La maladresse aussi, grâce à laquelle j’ai grandi. Car son erreur est mon bien, mon bien sa réussite. Je suis dans la détresse ; non pas celle des poètes, mais celle de ceux qui en savent trop depuis tout petits. Je sais que la vie est souffrance, pourtant… Je sais que Dieu est grand. Il est la Paix, Lui, Son contentement dans celui de maman.
Au centre de mon imaginaire, je me débats contre des bambins cruels, fictifs, qui se rient de moi, disent que ma maman n’a plus de voix. Sur eux mon avatar s’abat. Mon courroux ment, invente qu’elle est bien vivante, et que le monde se languit de son attente ; la mienne.
Tigre de papier, je fixe l’horizon et crois percevoir ses traits. L’envie me prend presque de la rejoindre. Elle est partie d’un départ à venir. Comment donc craindrais-je de la retrouver ? Sa voix, moi je l’entends ; chaque jour, pour ne point l’oublier. Alors qu’importe ces importuns, qui ne savent rien ni de la mort, ni du destin.
Terribles sont les apparences du détachement. Pas assez homme, donc ne comprend point. Jamais ne laisse transparaître une once de chagrin, parce que trop enfant, trop humain. La souffrance est un masque, ou plutôt le masque une souffrance. Au fond, tout à l’intérieur, la fièvre bout. Dans un temps rétréci, des interrogations à l’infini, de bout en bout. De l’invulnérabilité, l’insensibilité, premiers signes d’une caravelle d’enfant lourdement touchée, percée comme un lourd secret. Le combler, ce trou béant, par l’amour incorrigible, l’attention d’un parent. Un paquebot, une étoile parmi les bateaux, afin de sortir le courage de l’eau, déposer une caresse sur la peau.
Puisqu’il y a la conscience de la mort, d’abord. Or, dans la cale profonde du bateau de mon cœur, elle s’abrite, se tait fort. À l’ombre de mes oublis, et durant un temps, elle a dupé le capitaine que je suis. C’est dans la tempête, sur le ponton du navire à la dérive, que sa présence elle m’offrit. Les gouttes du ciel se mêlaient inlassablement aux larmes miennes.
Souffrance invisible, donc ; au creuset de mes démons, une mansuétude diluvienne. Je souris d’avoir compris. Encore, je souris d’avoir souri d’avoir compris. « Il faut jeter l’ancre », voici ce qu’elle me dit. Délicatement je la saisis, et la jetai dans mon océan agité. Une ancre légère, une âme ensemencée. Mon vaisseau fit cent tours, voyagea jusqu’au pourtour, car désormais le souvenir de la mort serait mon labour.
En songe, il m’arrive de tomber malade. Vieil enfant étendu sur le divan – moi, impotent – je m’entends dire à qui partage mon sang : « Renvoyez les médecins, les exorcistes et les magiciens, ceux qui ne peuvent rien. Si je quitte la vie, ne me pleurez pas outre mesure. Car, contre Dieu qui me réclame, je ne puis aucun parjure. Si je guéris de mes blessures, c’est qu’alors sur elles vous avez posé la main, m’avez pris dans les bras, serré fort, accompagné sur le chemin qui mène jusqu’au matin. »
Vite, chaque jour je guéris, sans grand mérite. Certains ont dit que le temps soigne toutes les blessures. Comment faire, alors, lorsque ma seconde est devancée par ma première, laquelle impose au temps de se tenir en arrière ? Interrompu dans l’expérience de pensée, en pleine divagation, par la voix de maman – trois fois – puis par celle de papa, enfin. Enfin, car leur sourire appelle le mien. Du début à la fin, leur lumière sur mon chemin.
Avait coulé, de mes prunelles, une saveur de liqueur qui n’était plus la même. Mes larmes ont mûri ; j’avais appris l’urgence de mieux aimer. C’est ici, juste à cet endroit de la confiance, que je trouve la sérénité. Au bord de Son amour, de ma poitrine Il a retiré la gêne. Une sérénité triste, certes, mais une sérénité quand même.
Khadir Ouadah