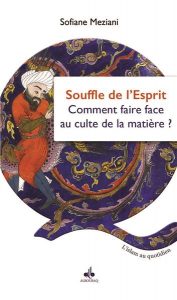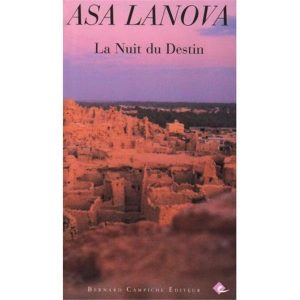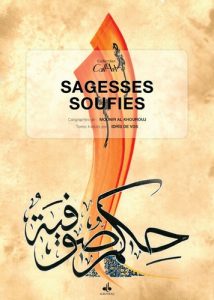Mizane.info publie un texte littéraire de réflexion sur le destin, la mort et la rédemption de Khadir Ouadah. Khadir Ouadah est professeur de philosophie, diplômé en éthique islamique et titulaire de plusieurs masters en droit public, droit privé, en philosophie du droit et droit politique à l’université Paris II.
Une journée seulement, ou une semaine, ou un mois, ou une année, ou dix ans – au fond, quelle différence – l’espace qu’il nous reste à visiter, le temps à voyager.
La vie qui passe, le temps qui la consume, se mue dans nos esprits en une impression fugace. Un flash de lumière, ou de ténèbres. Tellement de temps devant nous, avons-nous pensé.
Alors dépensons, gaspillons ! Après tout, ce temps nous appartient. N’est-il pas notre propriété ? « La propriété, c’est le vol », prophétisait Pierre-Joseph Proudhon.
Capitalistiquement, spirituellement. Nous sommes riches du temps, riches de souffles, riches d’illusions. De riches inconscients. Riches, apparemment.
Tellement de temps derrière, déjà. Cependant, les derniers instants sont les plus importants. La fin détermine le tout, l’extrême limite.
Je voulais le rattraper, lui crier que je m’étais trompé, que nous ne nous sommes pas bien connus. Mais il est loin déjà, et mes jambes sont fatiguées.
L’on vit, sans questions sur la vie. La jeunesse n’est qu’un épiphénomène, une apparition ; une jeunesse sans jeunesse.
Elle est venue un moment, a sonné à ma porte. « De si beaux traits », me disais-je en mon for intérieur. Elle était là – je me souviens encore – juste devant, souriant de mes maladresses, mon laborieux apprentissage.
Elle buvait à ma santé, me procurait force et courage, parfois témérité. Seulement, alors qu’elle avait fini par se fondre dans mes murs vétustes, je vis un soir ses bagages préparés au pied du vieil escalier.
« Je dois partir pour un long voyage », me dit-elle tendrement. « Vous reverrais-je un jour ? », demandais-je naïvement. Elle était partie, définitivement.
Au-dehors, la pluie ne cessait de tomber. Je craignais pour elle, que sa distinction ne se noie, que malgré toute sa vitalité, sous le poids des années elle ne croule, goutte à goutte, ne s’écoule.
La montagne ! Aussi imposante et auguste sois-tu, c’est tout de même toi qui craquelles, également, sous le poids des paroles lourdes.

Je pensais que rien ne pouvait t’atteindre, que tu étais droite comme un piquet ; mais réfléchie ? Une montagne raisonnable, une montagne humble.
Au moins as-tu médité ta situation, as-tu été juste. Toi, encore, tu n’as pas de cœur, donc point de cadenas de malheur, ni d’autre espace que ta surface où la dureté demeure.
Moi, je porte la responsabilité de mes chaînes, le risque de ma liberté. J’ai dit oui sans peur, injustement, de manière injustifiée.
Pourtant, devant tant d’infini, devant tant de silences apparents aussi, le chemin se dessine. Notre allure est vive, indifférente.
Nous n’avons point été prévenus, nous ne sommes pas prêts. Pourquoi avoir érigé ce mur à l’intérieur, planté des épines sur nos cœurs ?
Peut-être est-il préférable d’ôter toutes ces parures comme l’on dépose les armes. Marcher nu sur le sentier, nu de tout orgueil, de toute jalousie. Déposer à terre, cette fierté d’être homme, homme de raison, quand ce n’est point homme de bien. Creuser, l’enfouir au plus profond, creuser sans fin.
L’histoire a commencé lorsque nous portions de belles parures, de magnifiques ornements. Nous nous voyions beaux car nous l’étions, véritablement.
Par mauvaise fortune, les affres du désespoir, par centaines, altérèrent notre primordiale nature, notre beauté originelle.
Les nouvelles idoles bâtirent leurs propres temples dans notre chair, aiguisèrent les barreaux de notre prison nucléaire.
Enfermée la lumière première, ce sont des voiles sombres qui descendent par nuées sur les cœurs ; maladie séculaire.
Les nombreux points noirs donnent l’impression d’une forme, d’une créature pudique. Pudique de ses péchés, qu’elle cache aux yeux de tous, mais ne craint pas de livrer à toute intimité.
Ses griffes, aussi tranchantes que de mauvais arguments, ou de mauvaises raisons, ou qu’un amour blessé, menacent tout passant, tout étranger.
De sorte à ce qu’aucun hôte, aucun voisin ne pourrait l’atteindre ni la visiter.
En effet, certaines personnes voient, mais ne voient pas. À commencer par soi. Saluer, prendre la main, sourire : tout ceci, voir quelqu’un.
Avant que, faute de ne pouvoir être vu ne serait-ce que par un, cet invisible anonyme ne crève les derniers yeux, du cœur, qui sauraient encore le faire se sentir être au monde.
Être au monde, déjà. Être au monde dans la multitude, seul. Et retourner à l’origine, toujours seul. Seul devant le Seul, pour reprendre la formule de Plotin. Ceci est bien écrit.
Peut-être est-il préférable d’ôter toutes ces parures comme l’on dépose les armes. Marcher nu sur le sentier, nu de tout orgueil, de toute jalousie.
La nudité serait-elle la conséquence de nos péchés ? Alors couvrons-nous, tout comme Adam et Eve, de feuilles du Paradis.
Mais je ne vois pas de Paradis à l’horizon, ni de feuilles à proximité, sur cette terre desséchée ; rien que le monde qui a fané. Là, il y a un arbre, las. Mais il est faible, frêle, instable, trop humain.
Continuons sur le chemin, peut-être trouverons-nous de quoi couvrir notre chagrin. Se couvrir, comme l’on couvre les fautes de notre prochain. Et si je l’étais, mon prochain ?
Déposer à terre, cette fierté d’être homme, homme de raison, quand ce n’est point homme de bien. Creuser, l’enfouir au plus profond, creuser sans fin.
Être de cette catégorie, de ceux qui creusent, non pas de celle qui a un pistolet chargé. Le pistolet du jugement, de la suffisance.
Ne point être sage, mais (se) figurer parmi les chercheurs, les explorateurs. Se mettre en quête pour longtemps, voyager dans les veines de la terre jusqu’au soufflement.

Puis s’y établir, comme toute vie, inéluctablement. Jusqu’à nouvel ordre, jour de jugement.
L’abandonner seule, cette fierté, avec ses pensées, quitter sa pièce. Ne vous retournez point lorsqu’elle gémit, même si ses larmes vous font mal.
Au fond, ce sont les nôtres aussi. Recouvrez-la de terre délicatement, sans la consoler ni la fendre. Et si vous pleurez, alors éparpillez sur sa tombe vos larmes de compassion.
« Rance fierté, tu deviendras semence. » Un jour viendra où la terre remuera lentement son ventre. Une fissure, un enfantement.
La voilà qui se lève comme au premier jour, et étire sa minuscule tige vers le ciel. Elle admire le soleil, elle respire enfin.
Le vent qui se lève caresse son visage d’or, ennoblit son corps fragile. Là-haut, les imposantes fresques de coton assistent à sa naissance et contemplent son innocence, affectueusement.
Elles s’entendent pour faire descendre l’eau dont elle a besoin pour grandir. Plus tard, des témoins pourront dire : « Du mal a jailli la fleur ! Du mal a jailli la fleur ! »
« Pourquoi ? », voici la question insensible à notre vanité d’antan. D’abord, pourquoi la mort ? Puis, pourquoi la vie ? Pourquoi la mort avant la vie ?
Au fond, qu’est-ce que savoir, ô homme doué de raison ? La vie s’arrête un jour. Vivre avec la conscience de la mort, toujours.
C’est elle seule qui rappelle le sens de notre existence, de nos actes. Beaucoup trop de cœurs dormeurs, ceux du val. D’aucuns ne voudraient pas connaître cette vérité. Certains en ont peur, d’autres l’ont oubliée.
Il faut être courageux contre soi, pour soi. Apprendre à pleurer pour l’humanité. Nous parlons de la véritable connaissance, non pas celle de la raison, mais la connaissance ultime du cœur.

Il ne s’agit pas de savoir que l’on va mourir, simplement, mais de savoir que ce peut être la virgule finale de ma dernière ligne, la première difficulté de ma deuxième vie.
Brusquement émerge à ma conscience cet iceberg de lucidité, tombe de ma plume cet éclair térébrant qui perce ma brume, et me renvoie à ma finitude, ma fragilité. La mort sillonne les ruelles, observe les figures de nos portes. Tout est si dérisoire face à elle.
Je crains la colère, le tonnerre. Que les liens de parenté se renouent ! Disons « je t’aime » à ceux que l’on aime, tant que l’on peut encore.
C’est urgemment essentiel, essentiellement urgent. Car, dans la conscience croyante, l’on ne fait pas ce que l’on veut ; tout juste ce que l’on peut, comme Il veut.
Notre zone de confort est aménagée, pas mal rangée. La mort est cette tornade qui met notre chambre en branle.
Au dérangement de l’ignorance a succédé le capharnaüm du discernement. Il faut ramasser, tout reconstruire.
La mort ravit la première, sans qu’on lui ravisse un sourire. La mort ravit la dernière, jusqu’aux Anges élevés, sans que même elle ne puisse s’oublier.
La mort est une science sûre, science dont les savants ne sont que trop rares, ou déjà partis. Une encre posthume dans un livre blanc bien rempli.
Malade ou en bonne santé, « demain » n’est qu’une hypothèse, une projection qui n’a peut-être jamais existé. Malade, ai-je dit ? Orphelin, pauvre, triste, rejeté.
Pourquoi la souffrance ? Son aurore est tempétueuse. Elle nous frappe d’où nous ne l’avons pas vu venir, nous arrache de nos lits, de notre doux sommeil, nous secoue tel un enfant terrifié.
C’est que sa rencontre est assez brute. Cependant, en d’autres temps, d’autres lieux, elle est aussi goûteuse que le miel, aussi fougueuse que l’amour aveugle, et se présente sous la forme qu’elle entend : femme, enfant, argent …
Parfois encore, la mort nous frappe deux fois. Voilà un privilège réservé aux élus, aux épargnés de dernière minute, aux êtres aimés de la première heure.
La mort première est celle dont nous pensons ne pas avoir réchappé. Elle était là, une horloge à la main.

Pourtant nous sommes bien éveillés. Pourquoi ? Une réponse que l’on a tant cherchée : pourquoi. Une évidence soufie.
Son zénith est de comprendre, d’apprendre à dire merci. Merci à nos père et mère qui, malgré leurs imperfections, ont mis de leur lumière en nous.
Les aimer, au-delà de leurs blessures, jusque sous les pieds de maman. C’est ici que se trouve la maison de la paix.
Merci de cette vie parfois difficile, de cette nature simple, miraculeuse, si ordinaire. Merci de m’avoir appris à pleurer, le sens de mes larmes, de ne pas tout me dire, de me protéger de ce que je ne pourrais supporter.
Mon dernier carré d’innocence, l’esquisse d’un sourire, l’éclat d’une aumône. Merci que je puisse le dire.
C’est donc cela, que d’être déchu. L’être jusqu’à L’oublier, s’oublier, se perdre. Perdu à la surface, c’est au fond que je me suis retrouvé. Tu m’y attendais. Ce n’est que déchu que Tu m’es revenu, m’as revêtu, puis m’as élu.
Son soir est dansant. Sur la scène céleste, la lune et les étoiles se meuvent en toute joie. Les astres nocturnes sautent, s’entrelacent et tournent au rythme du silence éternel.
Mais, à la vérité, du début à la fin, jamais il n’y eut de silence pour qui prête l’oreille ; seulement l’Éternel. Le ciel semble heureux, apaisé. Son ballet est toute générosité. « Faites largesses de ce que vous chérissez. »
Avant que le spectacle ne termine, que le soleil ne se lève, la dernière lumière du soir brille de cet enseignement : donner de ce que l’on chérit, à ceux que l’on aime, à ceux que l’on voudrait aimer, à ceux dont on voudrait qu’ils nous aiment.
Elle est la dernière note triste, le dernier temps de nos souffrances, nos belles souffrances.
Nous l’avons trouvé, le voilà ! Enfin ! Notre vêtement… Je m’en approche pour être sûr, et m’incline pour le cueillir, sentir sa douceur.
C’est le vêtement de la conscience du Miséricordieux, celui qui me sauvera, peut-être. Je m’empresse de l’enfiler, de m’y réchauffer.
Pour continuer sur le sentier, l’humilité sera ma lumière, et la confiance mon bâton de berger.
Je lève la tête vers le ciel, et souris d’avoir trouvé le trésor, alors que j’étais nu hier encore.
J’observe le chemin, je le vois dorénavant. La destination me semble lointaine, la distance entre mon index et mon majeur.
Soudain je me souviens, et résonne dans mon esprit l’écho de ce que poétisait jadis Léo Ferré, qu’avec le temps va, tout s’en va, qu’avec le temps, on n’aime plus.
Il avait raison, pas tout à fait, en partie. Car, quand tout fanera, s’évanouira, subsistera le Maître de l’amour, Sa majesté, Sa noblesse.

Devant nos yeux, témoins. Car persistera l’amour, au-delà du temps. De Sa lumière, couverts. Me voilà, je retourne ! Je fais le premier pas, avec l’intime espoir qu’il en sera compté dix.
C’est donc cela, que d’être déchu. L’être jusqu’à L’oublier, s’oublier, se perdre.
Perdu à la surface, c’est au fond que je me suis retrouvé. Tu m’y attendais.
Ce n’est que déchu que Tu m’es revenu, m’as revêtu, puis m’as élu.
J’avais renié cent fois, désespérément sans foi, et Tu as couru à moi, lorsque j’avais froid.
Khadir Ouadah
A lire aussi :