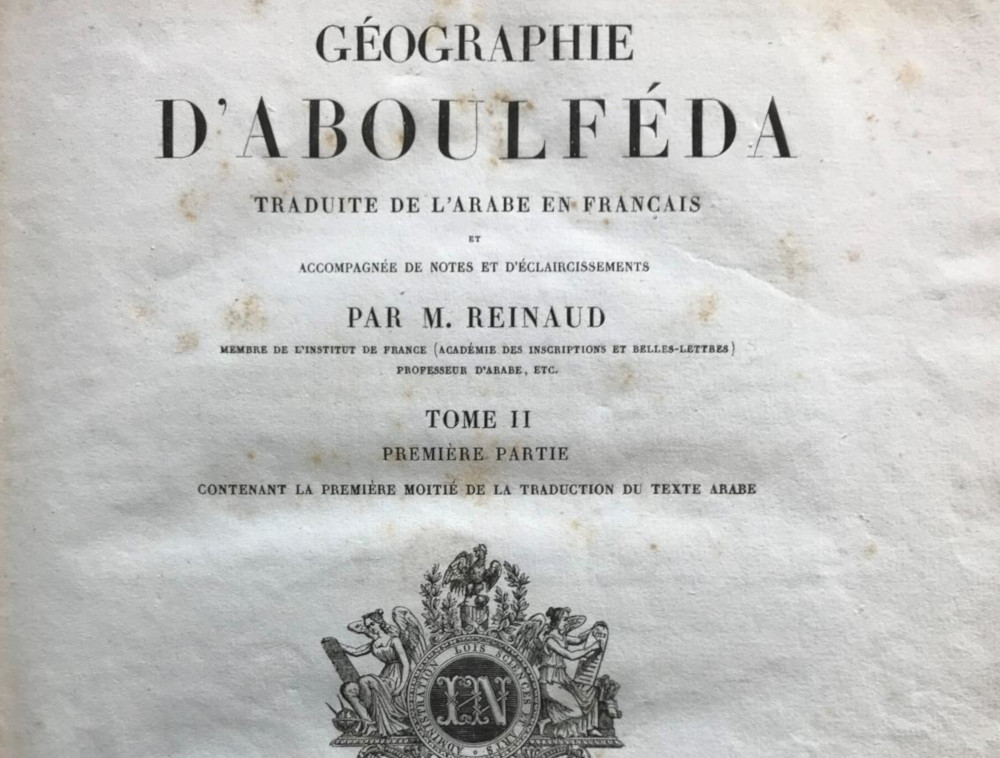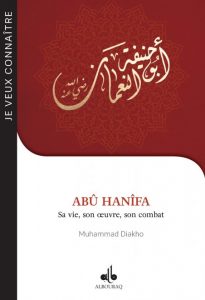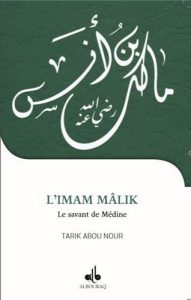Dans quelles conditions historiques, l’essor des sciences arabes prit-il son envol dans les premiers temps de la civilisation musulmane ? C’est l’objet d’un des textes les plus aboutis de la traduction orientaliste française consacrée à la vie et l’œuvre du géographe et historien Abou Al Fida, dont Mizane.info reproduit de larges extraits de l’introduction.
Le caractère distinctif de l’esprit des anciens Arabes est une tendance prononcée pour les recherches d’érudition et une aptitude particulière pour les spéculations scientifiques : c’est par les travaux dont ces deux branches de connaissances ont été chez eux l’objet que leur littérature est surtout remarquable. Il fut dans les destinées de ce peuple de suivre dans son développement intellectuel et politique une voie toute différente de celle qu’ont parcourue les autres fractions de la grande famille humaine. Il ne traversa point ces phases de lente élaboration, de progrès et de vicissitudes qui marquèrent partout ailleurs l’enfantement de chaque nationalité.
Quelques années seulement après les premières prédications de Muhammad, en 622, les tribus de la péninsule arabique, converties à sa doctrine religieuse et rangées sous son drapeau victorieux, formaient déjà une puissance nation qui, sans être passée par la faiblesse de l’enfance, entra aussitôt dans le plein exercice de la virilité. Elles avaient conquis les plus belles provinces de l’empire grec, le vaste royaume de Perse et la vallée de l’Indus, tandis que d’un autre côté, vers l’occident, elles se répandaient comme un torrent le long de la côte septentrionale de l’Afrique et portaient leurs déprédations dans les îles de la Méditerranée.
Ces succès des Arabes furent dus non seulement à l’enthousiasme religieux et militaire que le prophète avait su leur inspirer, mais encore à l’habileté des hommes de guerre qui se révélèrent tout à coup parmi eux, et aux talents politiques et administratifs des successeurs immédiats de Muhammad.
Dans cette première période, qui s’étend depuis la fondation de l’islamisme jusqu’à la chute de la dynastie des Omeyyades, dont le siège était à Damas, et, qui dura l’espace d’un siècle, les conquêtes, la propagation du Coran, l’organisation de l’empire et souvent aussi les discordes civiles occupèrent les musulmans, et ne leur permirent pas de donner l’essor à ces instincts littéraires qu’ils manifestèrent bientôt après avec tant d’éclat. Cependant, les circonstances politiques en préparaient déjà le développement.
Mou’awiyyah, élevé au khalifat, rendit héréditaire dans sa famille un pouvoir d’abord électif, et les enfants d’Abbas et d’Ali, poursuivis par son ombrageuse politique, se réfugièrent dans l’intérieur de l’Arabie, en Mésopotamie et dans les provinces orientales de la Perse. Là, dans les loisirs forcés de leur exil, ces princes proscrits se prirent de goût pour l’étude des sciences, ravivée et devenue très florissante depuis un siècle dans les pays où ils étaient venus chercher un asile, grâce à la protection active et généreuse dont l’avait entourée Khosrou Anouschirvan.
L’on sait que ce prince, désigné par nos historiens occidentaux sous le nom de Cosroës le Grand, et l’un des plus illustres de la dynastie des Sassanides, qui gouverna la Perse depuis l’année 226 jusqu’en 637 de Jésus Christ, avait attiré à sa cour les philosophes grecs persécutés par les empereurs de Byzance, et qu’il fut le fondateur de la célèbre école de Djondy Sapour.
Lorsque la famille des Omeyyades ne fut plus représentée que par des tyrans ou des princes dégénérés, qui méritèrent la haine et le mépris publics, l’étendard de la maison d’Abbas fut arboré publiquement dans le Khorassan, l’une des provinces de la Perse orientale. Une armée, recrutée en majeure partie de Persans, s’avança vers l’Euphrate, et mit fin au règne des Omeyyades.
Les Abbassides, qui leur succédèrent dans le khalifat, apportèrent sur le trône cet amour éclairé des lettres et des sciences, ces habitudes d’une civilisation élégante et raffinée qu’ils avaient puisées dans les pays où ils avaient long temps vécu. Ils appelèrent auprès d’eux des chrétiens nestoriens, les hommes les plus habiles de cette époque dans la médecine, les mathématiques, l’astronomie et l’astrologie.
Dès que le chef de la dynastie abbasside, le khalife Almansour, vit le pouvoir affermi dans ses mains, il s’attacha à tourner vers les recherches scientifiques le génie actif et pénétrant des Arabes. Par ses ordres, plusieurs livres grecs furent traduits dans la langue du Coran. Ce prince, au dire des auteurs musulmans, joignait à toutes les qualités qui font le grand souverain une vaste érudition ; il excellait dans la jurisprudence, dans la philosophie et l’astronomie. Attirés par ses libéralités, les savants accoururent de toutes parts dans la ville de Bagdad, qu’il avait fondée pour en faire sa capitale, et où il institua de nombreuses académies.
Plusieurs des successeurs d’Almansour, Haroun Alraschid, son fils Almamoun, Alwathek et Almothawakkel, marchèrent sur ses traces. Haroun Al Rachid aimait les savants, et surtout les poètes, qui étaient les commensaux de son palais et les compagnons de tous ses voyages. Celui de tous les khalifes qui montra au plus haut degré ce noble goût des lettres, et qui fit le plus de frais et d’efforts pour en propager la culture, est sans contredit Almamoun, qui monta sur le trône en 813.
Non content de favoriser les chrétiens nestoriens et les Juifs de ses états qui avaient été jusqu’alors en possession des sciences grecques, il voulut aussi mettre les musulmans à même de consulter les ouvrages originaux qui en contenaient le dépôt ; il rassembla à grands frais tous les livres grecs qu’il put se procurer, et en forma une riche bibliothèque qu’il ouvrit aux savants de sa cour.
Pour connaître l’esprit et les tendances du mouvement intellectuel qui s’opéra chez les Arabes à l’avènement des Abbassides, il est nécessaire de remonter jusqu’à son origine. Ce sont les médecins syriens attachés au service des khalifes qui en furent les promoteurs. Ainsi, dès le principe, ce mouvement prit surtout une allure scientifique.
Chez les premiers Arabes, l’art de guérir était fondé sur un empirisme simple et grossier, suffisant pour les besoins d’une société patriarcale et rudimentaire. Il paraît cependant qu’il existait dès lors un centre d’études médicales à Sanaa, dans l’Arabie Heureuse ; mais l’existence de l’école de Sanaa s’explique par le fait que cette contrée, riche de ses productions naturelles et de ses trésors, accumulés par un commerce lucratif qui remontait à la plus haute antiquité, était le foyer d’une civilisation supérieure à celle du reste de la péninsule.
Les Arabes fréquentaient aussi en Perse l’école de Djondy Sapour, où étaient professées les doctrines de l’Inde et de la Grèce. Plus tard, l’opulence et le luxe, avec tous les excès qui en sont inséparables, ayant introduit parmi les populations de Bagdad et à la cour des khalifes des maladies inconnues aux primitifs habitants du désert, ces souverains attirèrent auprès d’eux les médecins syriens, qui étaient alors en très grand renom. Dans le nombre, on cite les deux Bokhtjésu et Jean Mésué, employés au service d’Almansour et de Haroun, et qui furent chargés de traduire plusieurs ouvrages grecs de médecine.
L’étude de la médecine des Grecs conduisit à celle de leur philosophie, à laquelle il fallait être initié pour entendre les livres qui traitaient de l’art de guérir. C’est ainsi que Galien appuie souvent ses déductions sur les théories d’Aristote. Les médecins syriens et arabes cultivèrent à la fois ces deux branches de connaissances, et Rhazès (Razy), Avicenne (Ibn Sina) et Averroés (Ibn Roschd) se distinguèrent dans l’une et dans l’autre.
L’étude des mathématiques naquit chez les Arabes du goût que ces peuples, et en général tous ceux de l’Orient, ont eu, dès la plus haute antiquité, pour l’astronomie et l’astrologie. Les Grecs leur offraient à cet égard des travaux précieux qu’ils s’empressèrent de leur emprunter, et dont ils firent, comme eux, une application immédiate et féconde à la science géographique. L’un des plus curieux, des plus importants traités en ce genre que les Arabes nous aient laissés, puisqu’il renferme tout ce qu’ils ont su sur cette matière, est celui d’Aboulféda, dont nous essaierons de donner une idée d’après la traduction que vient de publier l’un de nos plus habiles orientalistes, M. Reinaud.
(…)
L’étude de plusieurs langues, négligée auparavant et parmi lesquelles le sanskrit tient le premier rang, nous a donné accès à des littératures aussi riches qu’originales. De nombreux manuscrits, transportés dans les grandes bibliothèques de l’Europe, recèlent une mine inépuisable de documents que chaque jour voit mettre en lumière. Les savants ont pu contrôler ou éclaircir les récits des Arabes, des Persans et des Chinois, qui, mieux que toutes les autres nations, : ont connu et décrit les régions inaccessibles de l’Asie centrale. Les Arabes nous ont fourni les renseignements les plus précis que nous possédions sur l’Afrique, dans l’intérieur de laquelle ils ont pénétré plus avant qu’aucun de nos voyageurs modernes.
A lire aussi :