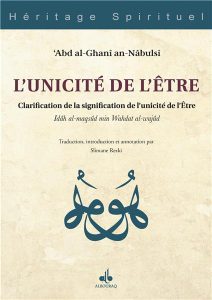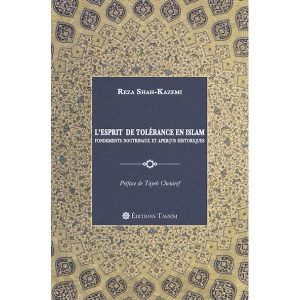Humanisme, rapport à la Transcendance de Dieu, éloge de l’individu : tels sont les thèmes traités dans la dernière chronique de Dawud Salman que publie Mizane.info.
Dans les débats relatifs à la modernité et à la Tradition, il est souvent question « d’humanisme », or, ce terme est souvent chargé idéologiquement tout en étant confondu avec les valeurs humaines et l’Humanité.
Par humanisme, il faut entendre le paradigme selon lequel, la vie humaine, comme le cosmos, ont été désacralisés, mais où paradoxalement parlant, l’Homme a été « idolâtré », instituant ainsi le culte de l’Homme, où ce dernier devient le « centre et la mesure de toute chose », c’est-à-dire où son ego devient son idole et constitue son horizon indépassable, alors que dans sa condition humaine, l’Homme est conditionné et limité, constituant ainsi un non-sens manifeste.
L’Homme se fait ainsi « faux-Dieu », mais se coupe du Divin et se prive ainsi de tout principe transcendant, pourtant seul moyen pour l’Homme de s’élever spirituellement et de combler l’aspiration spirituelle qui l’habite.
Frithjof Schuon disait à ce sujet : « Sans conteste possible, c’est en dernière analyse le narcissisme humaniste, avec sa manie de la production individualiste et illimitée, qui est responsable d’une profusion somme toute bien inutile de talents et de génies. La perspective humaniste, non seulement propose le culte de l’homme, mais aussi – et par là même – entend parfaire l’homme selon un idéal qui ne dépasse pas l’humain ; or cet idéalisme moral n’a aucun avenir du fait qu’il dépend entièrement d’une idéologie humaine ; c’est un tel idéal qui veut que l’homme soit toujours productif et dynamique, d’où le culte du génie précisément. L’idéal moral de l’humanisme est inefficace du fait qu’il dépend du goût du jour, ou de la mode si l’on veut (1) ; car les qualités humaines, qui impliquent par définition la volonté de se dépasser, ne s’imposent qu’en fonction de quelque chose qui nous dépasse. De même que l’homme ne saurait avoir sa raison d’être en lui-même, de même ses qualités ne sauraient représenter une fin en soi ; ce n’est pas pour rien que la gnose déifiante exige les vertus. Une qualité ne s’impose qu’à condition de relever en dernière analyse de l’Être nécessaire, non de la simple contingence, donc de ce qui est simplement possible. La contradiction initiale de l’humanisme, c’est que, si tel homme peut se prescrire un idéal qui lui plaît, tel autre homme peut tout aussi bien, et pour la même raison, se prescrire un autre idéal, ou ne rien se prescrire du tout ; en fait, l’humanisme amoraliste est presque aussi ancien que l’humanisme moraliste. Après la candeur moralisante d’un Kant ou d’un Rousseau, survint l’amoralisme aventureux d’un Nietzsche ; on ne nous dit plus que « l’humanisme c’est la morale », on nous dit maintenant que « la morale c’est moi » – cette morale fût-elle absence de toute moralité.
(1) La perfection ostentatoirement humaine de l’art classique ou académique n’a en effet rien d’universellement convaincant ; il y a longtemps qu’on s’en est aperçu, mais ce fut uniquement pour tomber dans l’excès contraire, à savoir le culte du laid et de l’inhumain, en dépit de quelques oasis intermédiaires, certains impressionnistes par exemple. Le classicisme d’un Canova ou d’un Ingres ne convainc plus personne, mais ce n’est pas une raison pour n’admettre que les fétiches de Mélanésie »[1].
L’écrivain et sociologue français Michel Maffesoli écrivait : « Quant à l’idéal du politique au service du bien commun, il n’est, la plupart du temps, qu’un faux nez masquant bien mal les plus sordides querelles de personnes. Le mensonge envers soi comme forme ultime du mensonge envers les autres devient une habitude dans les sociétés qui ne sont plus assurées des valeurs qu’elles professent. C’est cela le processus de l’incantation : on clame haut et fort, comme pour s’en convaincre, ce à quoi l’on ne croit plus et l’on acquiert ainsi, à bon marché, la bonne conscience dont tout un chacun est friand. Lévi Strauss n’hésite pas à soupçonner la Révolution française d’être à l’origine des catastrophes qui se sont abattues sur l’Occident et ce, parce qu’elle a détruit les libertés réelles au nom d’abstractions nuageuses. C’est contre l’abstraction et son idéalisme brutal et désincarné qu’on doit promouvoir l’antique sagesse du discernement, celle qui, avec humilité, sait reconnaître le vaste mouvement vital et en apprécier l’insondable fécondité »[2].
Frithjof Schuon dira justement à propos de la conscience et du phénomène religieux ceci : « Un trait essentiel qui distingue l’homme de l’animal, c’est que l’homme sait qu’il doit mourir, alors que l’animal ne le sait pas. Or ce savoir de la mort est une preuve d’immortalité ; ce n’est que parce que l’homme est immortel que ses facultés lui permettent de constater son impermanence terrestre. Qui dit conscience de la mort dit phénomène religieux ; et précisons que ce phénomène fait partie de l’écologie au sens total du terme, car sans religion – ou sans religion authentique — une collectivité humaine ne saurait survivre à la longue ; c’est-à-dire qu’elle ne saurait rester humaine »[3].
C’est en effet ce que l’on constate, car l’Histoire a montré que lorsqu’une société perdait sa Tradition spirituelle, ou que sa forme traditionnelle avait complètement dégénéré, la société se désintègre, en s’éloignant de l’amour de la Vérité et du Divin, de la pudeur, de la justice sociale, et des valeurs sacrées.
Il dira également dans le même ouvrage que : « Il est bien commode de prétendre, comme on le fait si spécieusement de nos jours, que les religions se sont compromises au cours des siècles et que leur rôle est maintenant terminé. Quand on sait en quoi consiste réellement une religion, on sait également que les religions ne peuvent pas se compromettre et qu’elles sont indépendantes des abus humains ; en fait, rien de ce que font les hommes n’a le pouvoir d’affecter les doctrines traditionnelles, les symboles et les rites, aussi longtemps bien entendu que les agissements humains restent sur leur plan et ne s’attaquent pas aux choses sacrées. Le fait qu’un individu puisse exploiter la religion afin d’étayer des intérêts nationaux ou privés n’affecte en rien la religion en tant que message et patrimoine. La tradition parle à chaque homme le langage qu’il peut comprendre, à condition qu’il veuille bien l’écouter ; cette réserve est essentielle, car la tradition, répétons-le, ne saurait « faire faillite » ; c’est de la faillite de l’homme qu’on devrait parler plutôt, car c’est lui qui a perdu l’intuition du surnaturel et le sens du sacré. C’est l’homme qui s’est laissé séduire par les découvertes et les inventions d’une science illégitimement totalitaire ; c’est-à-dire une science qui ne reconnaît pas ses propres limites et qui pour cette raison ignore ce qui les dépasse. Fasciné par les phénomènes scientifiques autant que par les conclusions erronées qu’il en tire, l’homme a fini par être submergé par ses propres créations ; il n’est pas prêt à se rendre compte qu’un message traditionnel se situe sur un plan tout à fait différent, et combien ce plan est plus réel. Les hommes se laissent éblouir d’autant plus facilement que le scientisme leur donne toutes les excuses voulues pour justifier leur attachement au monde des apparences et par conséquent aussi leur fuite devant toute présence de l’Absolu »[4].

De là se pose la question aussi du sens de l’existence, et donc de la finalité proposée par la société actuelle, et qui conduit au suicide spirituel, et même souvent au suicide physique : « Un point sur lequel nous voulons insister au risque de nous répéter, est celui-ci : on parle volontiers du devoir de se rendre utile à la société, mais on omet de poser la question de savoir si cette société est utile, c’est-à-dire si elle réalise la raison d’être de l’homme et partant d’une communauté humaine ; de toute évidence, si l’individu doit être utile à la collectivité, celle-ci de son côté doit être utile à l’individu. La qualité humaine implique que la collectivité ne saurait être le but et la raison d’être de l’individu, mais que c’est au contraire l’individu qui, dans sa station solitaire devant l’Absolu et donc par l’exercice de sa plus haute fonction, est le but et la raison d’être de la collectivité. L’homme, qu’il soit conçu au pluriel ou au singulier, se présente comme un « fragment d’absoluité », et il est fait pour l’Absolu ; il n’a pas d’autre choix. On peut définir le social en fonction de la vérité, mais on ne peut définir la vérité en fonction du social »[5].
La notion du Bien est intrinsèquement liée à celle de la Vérité et de Dieu, comme il l’expliquait si bien (p. 64) : « Dans notre conscience de Dieu, notre désir de libération se rencontre avec la volonté de Dieu de nous libérer ; l’oraison est à la fois une question et une réponse. Si « la beauté est la splendeur du vrai », on peut en dire autant de la bonté ; si le bien tend à se communiquer, c’est qu’il tend aussi à nous libérer. L’injonction du Christ d’« aimer Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée », nous rappelle que la conscience de l’Absolu est absolue : que nous ne pouvons connaître et aimer Ce qui seul est, qu’avec tout ce que nous sommes. L’unicité de l’objet exige la totalité du sujet ; ce qui indique qu’en dernière analyse l’objet et le sujet se rejoignent dans la Réalité pure, à la fois Essence indifférenciée et Cause ultime, donc Source de toutes les différenciations. Qui dit Absolu, dit Infini, et par conséquent manifestation et diversité ; et la projection du Bien implique ontologiquement le retour au Bien »
Durant le 20e siècle, qui fut officiellement celui de la « mort de Dieu » comme paradigme idéologique à différents endroits sur terre, cela marqua aussi la fin de l’Homme, et conduisit l’humanité à perdre son âme, et la condamna à commettre les pires horreurs à l’échelle mondiale.
Néanmoins, si l’homme peut mourir, de par sa condition terrestre physique, ce n’est pas le cas du Divin, qui transcende les choses et modalités créées, et donc le temps comme l’espace.
« Le sens et la raison suffisante de l’homme est de connaître, et connaître, c’est inéluctablement connaître la Divinité. Connaissant la Divinité, l’homme L’affirme, La proclame, L’enseigne par la force des choses, puisque l’action manifeste Dieu par définition, et que la créature ne saurait donc rien faire qui n’affirme pas Dieu d’une façon quelconque; de même, l’être agit dès qu’il vit, et son action est la manifestation de sa vie. L’existence de l’homme, comme l’existence de tout être, n’a aucun sens, si ce n’est celui d’affirmation de la Divinité. La Divinité affirme l’homme en lui donnant l’existence, et l’homme affirme — et doit affirmer — la Divinité parce qu’il existe. Ne pas affirmer la Divinité ou affirmer autre chose que la Divinité n’aurait de sens que si nous n’existions pas; or cette supposition est absurde, car nous existons. L’homme ne peut donc s’empêcher d’affirmer la Divinité d’une manière ou d’une autre, puisqu’il existe. S’il nie ou plutôt croit nier la Divinité, l’existence même de celui qui nie affirme Ce qu’il nie. L’homme peut dire non, mais son existence dit oui. Qui nie la Divinité nie son existence, et elle lui sera enlevée — parce qu’il se l’enlève à lui-même — sans que pourtant elle puisse lui être enlevée effectivement, c’est-à-dire autrement que d’une manière symbolique. S’il arrive que des êtres nient inconsciemment leur existence en niant consciemment la Divinité, sans pouvoir s’enlever cette existence, ne se l’étant pas donnée, c’est encore parce que la Divinité est infinie, et que Son affirmation doit retracer également, selon son mode propre, cette Infinité : en effet, la Divinité, étant infinie, comporte toutes les possibilités inhérentes à l’Infinité; or le néant, tout en étant l’impossibilité, peut être dit possible dans un certain sens, sans quoi il ne serait aucunement concevable, ni à plus forte raison exprimable; il n’est certes pas possible en lui-même, car en lui-même il n’a aucune réalité ni existence; mais il est possible dans l’Infinité, et en raison de Celle-ci; en d’autres termes, si l’Infinité laissait en dehors d’Elle Sa propre négation ou plutôt l’apparence de Sa propre négation, Elle ne serait pas Infinité »[6].
En rapport avec la question de l’utopie de l’athéisme pour une société, le philosophe et philologue belge de Marcel De Corte (1905 – 1994) écrivait dans L’homme contre lui-même : « L’expérience historique démontre du reste qu’il n’y a jamais eu la moindre société humaine dépourvue de religion et qu’une société « laïque », amputée de toute référence religieuse, est aussi inexistante qu’un rond carré. Un individu peut sans doute être irréligieux ou athée, et encore dans une certaine mesure, plus apparente que réelle. Pour peu qu’on fouille son psychisme on découvrira, dissimulée en quelque repli, une divinité minuscule dont il dépend et à laquelle il sacrifie en secret. Cette idole changera de figure au cours de son existence, elle sera même remplacée par d’autres qui se succéderont à leur tour les unes aux autres: il n’en vénérera pas moins toujours «quelque chose» qui le dépasse et vers quoi il tend, ne serait-ce que sa propre image. Sartre a parfaitement décrit l’homme comme une «passion d’être [son propre] Dieu» et comme une tension – impuissante selon lui – vers la Transcendance. La plus élémentaire observation de son comportement le relève. Mais si l’homme peut, verbalement ou par inadvertance, récuser toute divinité en dépit de son comportement, il est rigoureusement impossible qu’un certain nombre d’hommes, rassemblés en société, soient dépourvus de toute croyance. Dès que les hommes entrent en relation, ils ont besoin de croire en « quelque chose » qui maintiennent solidairement le lien qu’ils ont entre eux. S’ils sont unis, c’est qu’ils participent à « quelque chose » de commun, dont la fixité ne peut être mise en doute et qui est analogue à l’immutabilité divine. De l’engagement mutuel par serment jusqu’à la patrie où la Providence nous a fait naître, toutes les formes sociales stables ont toujours été placées sous le signe ou dans le rayonnement de la Divinité. Chacun sait que l’homme est un être changeant et qu’il faut une « force » qui le dépasse pour le soutenir fermement en société. (…) Point de société [viable ou/et durable] sans référence à une entité transcendante quelconque. Les conventions et les contrats ne perdurent que par référence à une transcendance implicite »[7].
C’est exactement ce dont Dieu (Allâh) nous mettait en garde dans le Qur’ân :
« Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée de Dieu ? » (Qur’ân 28, 50).
« Ô Dâwûd, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas ta passion, sinon elle t’égarera du sentier d’Allâh » (Qur’ân 38, 26).
« Ils ne suivent que la conjoncture et les passions de [leurs] âmes » (Qur’ân 53, 23).
« Vois-tu celui qui prend sa propre passion pour divinité ? » (Qur’ân 45, 23).
Dans l’histoire de l’Humanité, il n’avait jamais été autant question des droits concernant les civils, de paix, et de lutte contre le terrorisme qu’aujourd’hui.
Mais paradoxalement, jamais la vie humaine n’était aussi insignifiante qu’elle ne l’est aujourd’hui, les guerres sales pour des ambitions profanes aussi nombreuses qu’à notre époque, tout comme la prédominance des manipulations de masse par les idéologues de la démocratie, la fourberie des apôtres des Droits de l’Homme, les « libérateurs » plus sanguinaires que les terroristes qu’ils étaient censés combattre.
Si notre époque n’est pas celle de la belle poésie, elle est par contre celle de la manipulation omniprésente de la parole, où la sorcellerie consumériste opère à travers les slogans et les belles (et fausses) promesses adressées à la foule, elle-même noyée dans les superstitions de notre temps.
A défaut de vivre la fraternité humaine et l’intelligence, on compense par d’interminables dissertations creuses qui ne servent qu’à se donner bonne conscience, quand on demeure incapable de vivre la spiritualité et la compassion.
On multiplie indéfiniment des lois (notamment contre la violence sexuelle ou contre la violence à l’encontre des minorités religieuses ou culturelles par exemple), mais les statistiques montrent une propension à la dégradation des relations sociales et humaines…
On compense par le bas (l’arsenal juridique, les beaux slogans) ce qui est engendré par un manquement du haut (transcendance, spiritualité).
Que ce soit envers le Divin, l’humanité, le règne animal ou la nature, notre époque est le témoin et le reflet du manque d’adab de l’humain envers tout ce qui l’entoure.
Ils nous ont dit : « Pas de Dieu ni de maître, alors suivez-nous », et ceux qui les ont suivi sont devenus leurs esclaves.
Ils nous ont aussi dit : « Nous n’avons plus besoin de religion, de spiritualité et de loi », et ils ont alors asservi leurs semblables en temps de paix, et en temps de guerre, ils ont commis les pires atrocités, devenant plus féroces que les fauves, et ont ainsi agi comme des démons sous apparence humaine.
Rejetant Dieu, éclipsant la spiritualité et moquant la morale religieuse, l’Humanité a sombré dans la barbarie la plus totale au 20e siècle, avec des répercussions tout aussi tragiques tout au long du 21e siècle, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique.
Quand la Loi disparait, les gens sont livrés à eux-mêmes, et n’offrent que le pire, sauf chez ceux qui ont su cultiver leur spiritualité et leur compassion.
Cela fut illustré abondamment tout au long du 20e et du 21e siècle, et dont nous pourrions citer un exemple marquant, apparu au cœur de l’Europe, et impliquant aussi bien les européens, que les américains et les russes.
Selon les recherches de l’historienne Miriam Gebhardt, les Français, les Américains et les Britanniques auraient abusé de 270 000 femmes allemandes : « Derrière la Libération, des faits beaucoup moins glorieux. Entrés dans l’histoire comme les libérateurs, ils ont violé des centaines de milliers d’Allemandes : une historienne écorne l’image des Alliés occidentaux héroïques, Américains en tête, en dévoilant les violences sexuelles massives lors de la chute du IIIe Reich. « Au moins 860 000 femmes et jeunes filles mais aussi des hommes et de jeunes garçons ont été violés par des soldats alliés (…) à la fin de la guerre et dans la période d’après-guerre. Ça s’est produit partout », écrit dans son ouvrage Lorsque les soldats arrivèrent (« Als die Soldaten kamen », éd. DVA) l’historienne allemande Miriam Gebhardt. Publié en mars, l’ouvrage a connu un fort écho en Allemagne, où ces viols à grande échelle étaient certes connus, mais quasi exclusivement attribués aux soldats soviétiques. Les viols commis par les GI américains sur des Françaises après le débarquement en Normandie, en juin 1944, étaient certes documentés, mais, globalement, les Alliés de l’Ouest – américains, français et britanniques – restaient auréolés du prestige immaculé des vainqueurs de la barbarie nazie. À l’inverse, l’image des troupes de Staline déferlant en avril 1945 sur Berlin et se jetant sur des femmes réduites au statut de gibier sexuel a longtemps imprégné l’imaginaire et la recherche allemands, a expliqué lors d’une conférence à Berlin Miriam Gebhardt, enseignante à l’université de Constance (Sud). « Ce qu’on ne savait pas, c’est que dans d’autres parties de l’Allemagne, les autres soldats alliés ont, de façon similaire, violé eux aussi des Allemandes », pointe l’universitaire, dont l’enquête s’est nourrie d’une masse d’archives inexploitée (documents militaires, récits de prêtres, demandes d’avortement…). Du fait d’une administration alors réduite à néant et du silence de nombreuses victimes, les documents ont été difficiles à trouver, confie l’historienne, qui s’est notamment appuyée sur les quelque 500 rapports adressés par les prêtres bavarois à l’évêché de Munich (Sud), dans lesquels sont consignées les exactions des soldats américains et, « occasionnellement », des Français : des viols, souvent en groupe, « dans quasiment tous les villages ». Ils évoquent une « chasse aux femmes et aux jeunes filles », violées et parfois même tuées, à l’image de cette Munichoise, « harcelée puis abattue » en pleine rue par des Américains. Selon les calculs de Miriam Gebhardt, sur les 860 000 Allemandes violées, « environ un tiers » (270 000) l’ont été par des soldats occidentaux : 190 000 par des GI, 50 000 par des Français, 30 000 par des Britanniques. De leur côté, les Soviétiques auraient, selon elle, commis au moins 590 000 viols. Jusqu’alors, on estimait que le nombre de victimes des Soviétiques oscillait entre 1 et 2 millions ».
Quant à la communauté musulmane, celle-ci est une entité plurielle et hétéroclite, comportant des lacunes et des imperfections, ainsi que des richesses insoupçonnées.
Sous ce rapport, elle est semblable aux autres communautés dans les déviances ou les excès liés à l’ego et à l’ignorance de certaines réalités complexes.
Mais ce qui la différencie des autres communautés, c’est son rapport vertical, immédiat, constant et immanent avec le Divin, tout en ayant conscience de la Transcendance Divine la distinguant clairement de toutes les choses ou notions relatives et créées, de même que la conscience islamique se caractérise par le sens de la justice en le vivifiant à chaque instant pour en faire son leitmotiv, tout comme de l’aspiration à l’excellence qui en constitue le but et le sens de toute son orientation spirituelle.

Au trouve de la Révélation islamique, se trouve ainsi la notion d’adab : « 11. Le manque de adab [=convenance] (qalil al-adab). Son adab s’amenuise, de même que sa modestie et sa pudeur vis-à-vis de Dieu et des créatures : « Il arrive à l’homme, dans les jours d’épreuve, de juger bon ce qui ne l’est pas. » Ainsi, il trouve bon d’agir mal envers Dieu, envers toutes les créatures de Dieu et envers lui-même, et c’est à peine s’il se rend compte que le grappin des mauvaises actions le saisit et le traîne du “manque de adab” aux “mauvaises actions”, le faisant descendre de deux abîmes et se retrouver une seconde fois au bord de l’épreuve. S’il tire la leçon de cet événement, il retraversera l’épreuve en courant sans s’y arrêter un seul instant et, de même, courra à travers le manque de adab avec la crainte d’être saisi à nouveau par ses tenailles. Car, « le croyant ne se laisse pas mordre deux fois au même trou » et « heureux qui apprend par l’expérience des autres, malheureux, au contraire, celui qui doit faire ses expériences lui-même »[8].
Nous citerons ici encore Frithjof Schuon concernant l’Islam : « L’attitude réservée de l’Islam, non devant le miracle, mais devant l’apriorisme judéo-chrétien — et surtout chrétien — du miracle, s’explique par la prédominance du pôle « intelligence » sur le pôle « existence » : l’Islam entend se fonder sur l’évidence spirituelle, le sentiment d’Absolu, conformément à la nature même de l’homme, laquelle est envisagée ici comme une intelligence théomorphe, et non comme une volonté qui n’attend qu’à être séduite dans le bon et le mauvais sens, donc par des miracles et des tentations. Si l’Islam, qui est la dernière venue dans la série des grandes Révélations, ne se fonde pas sur le miracle, — tout en l’admettant nécessairement, sous peine de ne pas être une religion, — c’est aussi parce que l’antéchrist « séduira beaucoup par ses prodiges » 11 ; or la certitude spirituelle, qui est aux antipodes du « renversement » que produit le miracle, — et que l’Islam offre sous la forme d’une lancinante foi unitaire, d’un sens aigu de l’Absolu, — est un élément inaccessible au démon ; celui-ci peut imiter un miracle mais non une évidence intellectuelle ; il peut imiter un phénomène mais non le Saint-Esprit, excepté à l’égard de ceux qui veulent être trompés et n’ont de toute façon ni le sens de la vérité, ni celui du sacré »[9].
Et à propos de Dieu, il dit : « Nous avons fait allusion plus haut au caractère non-historique de la perspective de l’Islam. Ce caractère explique, non seulement l’intention de n’être que la répétition d’une réalité intemporelle ou la phase d’un rythme anonyme, donc une « réforme », — mais au sens strictement orthodoxe et traditionnel du terme, et même en un sens transposé, puisqu’une Révélation authentique est forcément spontanée et ne relève que de Dieu, quelles que soient les apparences, — mais aussi des notions telles que celle de la création continuelle : si Dieu n’était pas à tout moment Créateur, le monde s’effondrerait ; puisque Dieu est toujours Créateur, c’est Lui qui intervient dans tout phénomène, et il n’y a pas de causes secondes, pas de principes intermédiaires, pas de lois naturelles qui puissent s’interposer entre Dieu et le fait cosmique, sauf dans le cas de l’homme qui, étant le représentant (imâm) de Dieu sur terre, possède ces dons miraculeux que sont l’intelligence et la liberté. Mais celles-ci non plus n’échappent, en dernière analyse, à la détermination divine : l’homme choisit librement ce que Dieu veut ; « librement », parce que Dieu le veut ainsi ; parce que Dieu ne peut pas ne pas manifester, dans l’ordre contingent, son absolue Liberté. Notre liberté est donc réelle, mais d’une réalité illusoire comme la relativité dans laquelle elle se produit, et dans laquelle elle est un reflet de Ce qui est »[10].
Et pour conclure : « Qui dit humanisme, dit individualisme, et qui dit individualisme, dit narcissisme et, par voie de conséquence, percée de ce mur protecteur qu’est la norme humaine ; donc rupture d’équilibre entre le subjectif et l’objectif ou entre la sensibilité vagabonde et la pure intelligence. Mais il est néanmoins malaisé d’avoir au sujet du génie « culturel » profane un sentiment tout à fait univoque : si, d’une part, on doit condamner l’humanisme et les principes littéraires et artistiques qui en dérivent, d’autre part, on ne peut s’empêcher de reconnaître la valeur de telle inspiration archétypique et éventuellement les qualités personnelles de tel auteur ; en sorte qu’on ne sort guère d’une certaine ambiguïté. Et le fait qu’une oeuvre, en raison de son message cosmique, puisse transmettre des valeurs que quelques-uns seulement peuvent saisir — comme le vin peut à la fois faire du bien aux uns et du mal aux autres —, ce fait rend nos jugements, dans bien des cas, sinon objectivement moins précis, du moins subjectivement plus hésitants ; bien qu’il soit toujours possible de simplifier le problème en spécifiant sous quel rapport une œuvre a de la valeur. Quoi qu’il en soit, ce que nous avons voulu suggérer dans la plupart de nos considérations sur le génie moderne, c’est que la culture humaniste, en tant qu’elle fait fonction d’idéologie et partant de religion, consiste essentiellement à ignorer trois choses : premièrement, ce qu’est Dieu, car elle ne lui accorde pas la primauté ; deuxièmement, ce qu’est l’homme, car elle le met à la place de Dieu ; troisièmement, ce qu’est le sens de la vie, car cette culture se borne à jouer avec les choses évanescentes et à s’y enfoncer avec une criminelle inconscience. En définitive, il n’y a rien de plus inhumain que l’humanisme du fait qu’il décapite pour ainsi dire l’homme : voulant en faire un animal parfait, il arrive à en faire un parfait animal ; non dans l’immédiat – car il a le mérite fragmentaire d’abolir certains traits de barbarie – mais en fin de compte, puisqu’il aboutit inévitablement à « rebarbariser» la société, tout en la «déshumanisant » ipso facto en profondeur. Mérite fragmentaire, avons-nous dit, car l’adoucissement des mœurs n’est bon qu’à condition de ne pas corrompre l’homme, de ne pas déchaîner la criminalité ni d’ouvrir la porte à toutes les perversions possibles. Au XIXe siècle on pouvait encore croire à un progrès moral indéfini ; au XXe siècle ce fut le réveil brutal, il fallut se rendre à l’évidence qu’on ne peut améliorer l’homme en se contentant de la surface tout en détruisant les fondements »[11].
En renonçant à Dieu, l’Homme menace son devenir en même temps que sa propre condition, et suit une voie autodestructrice qui emporte sur son sillage, tout son environnement.
Mais en renonçant à l’exploitation du monde pour des raisons égotiques, il sauve paradoxalement son intégrité par le Souvenir du Divin qui sacralise l’espace et le temps, – sans les idolâtrer -, en y introduisant les notions de Baraka et d’adab.
L’histoire et l’actualité sont ainsi formelles : l’Humanisme a détruit le monde et le conduit à la catastrophe dont les signes sont déjà visibles et alarmants, là où la Tradition spirituelle est la garante de sa préservation.
Dawud Salman
A lire aussi :
[1] Frithjof Schuon, Avoir un Centre, éd. L’Harmattan, 2010, pp. 17-18.
[2] Michel Maffesoli, La République des bons sentiments, éd. du Rocher, 2008, pp. 40-43.
[3] Frithjof Schuon, Le jeu des masques, éd. L’Âge d’Homme, 1992, p. 13.
[4] Ibid., p. 59.
[5] Ibid., p. 60.
[6] Frithjof Schuon, L’Œil du cœur, éd. L’Harmattan, 2017, Chapitre : Métaphysique et cosmologie.
[7] Marcel De Corte, L’homme contre lui-même, éd. De Paris, 2005, Chap. 5 : Le déclin du Bonheur, 1958, pp. 163-165.
[8] Muhammad ibn Ahmad Hashimi, L’Échiquier des Gnostiques (Shatranj al ‘Arifîn) ou L’Itinéraire du soufi , éd. Archè Milan, 1998.
[9] Frithjof Schuon, Comprendre l’Islam, éd. Gallimard, 1961, pp. 22-23.
[10] Ibid., pp. 23-24.
[11] Frithjof Schuon, Avoir un centre, éd. L’Harmattan, 2010, Chapitre 1 : Anthropologie intégrale.