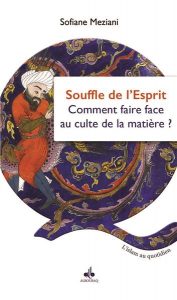Seconde partie de la contribution de Mouhib Jaroui proposée dans le cadre du débat lancé par la rédaction de Mizane.info sur les rapports entre islam et (post)modernité. Quelles sont les propositions contemporaines que l’islam peut offrir au monde ? Pour Mouhib Jaroui, il n’est pas de renaissance islamique possible sans un préalable : refaire de l’ijtihad (effort de réflexion) le moteur de l’Histoire !
La vision islamique peut-elle offrir une contribution pour notre époque et est-elle encore en mesure de servir de moteur à l’Histoire des Hommes ?
A l’inverse du marxisme, en islam ce n’est pas l’existence sociale et matérielle qui détermine la conscience individuelle, mais l’inverse ; ce sont les contenus moraux, intellectuels, idéologiques et philosophiques des Hommes qui font l’Histoire.
En islam, c’est l’Homme qui est sujet de l’Histoire : « En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes »[1].
Je ne crois donc pas à une histoire qui serait exogène ou « neutre », toute époque est endogène, c’est à dire voulue ou recherchée d’une façon ou d’une autre par les individus et les collectivités.
A partir de là, toutes les idéologies structurent peu ou prou l’Histoire.
L’islam ancré dans le réel
C’est pourquoi des penseurs et des théologiens musulmans nous ont mis en garde contre la focalisation sur l’eschatologie, ils ont mis l’accent sur le principe de causalité et ont vivement critiqué l’esprit de la résignation, de la capitulation ou le « tawakkul » à outrance face aux exigences de l’époque.
Par exemple, Mohammed Hussein Fadlallah a critiqué une conception erronée de la notion de l’invisible (al-ghayb) qui consiste à lier directement à Dieu, sans se soucier des causes cosmiques, sociales, psychologiques ou économiques, tout ce qui nous arrive sur terre, ce qu’il a appelé la « personnalité de l’invisible »[2].
De plus en plus de penseurs musulmans remettent en cause ce processus hégémonique de sécularisation (« al-‘almâniyya ashâmila »), bien plus large que la laïcité, c’est-à-dire « la séparation de toutes les valeurs religieuses, morales et humaines (qui transcendent les lois de la matière et du sensible) du monde, de l’Homme (dans sa vie publique et privée) et de la nature, de sorte que le monde devient une matière relative sans aucune sacralité.
Il déplore ainsi que les musulmans n’aient plus une culture de « takhtît », c’est-à-dire le sens de la planification, car noyés dans le monde de l’invisible, négligeant par là leur réel sensible.
De son côté, le diplômé de l’université d’al-Azhar Zakî Moubârak avait refusé de boire dans la coupe d’al-Ghazâlî y voyant dans sa philosophie morale une maladie de la volonté, si je puis dire, et un éloge de la capitulation face aux défis de la vie.
Son ouvrage « Al-akhlâq ‘inda al-Ghazâlî » a suscité lors de sa publication de vives polémiques.
Sans être exhaustif, terminons par un ouvrage peu connu de Mohammed ‘Âbed al-Jâbirî où il fait le même constat à propos de l’éducation morale chez al-Ghazâlî :
« Il criminalise l’adoption du principe de causalité, entérine le déterminisme fataliste (al-jabr), le tawakkul et la résignation, ce faisant à partir des fondements du ash’arisme et du soufisme »[3]. Ce que al-Jabirî appelle « la raison démissionnaire ».
Ce qui m’intéresse ici, ce n’est pas le procès que l’on fait à Ghazâlî, mais la lecture réaliste de la vision musulmane de sa propre tradition pour qu’elle puisse apporter sa contribution à la réforme du réel.
Les trois résistances à la sécularisation
Ce que j’observe par ailleurs c’est que de plus en plus de penseurs musulmans remettent en cause très explicitement ce processus hégémonique de sécularisation (« al-‘almâniyya ashâmila »), bien plus large que la laïcité, c’est-à-dire « la séparation de toutes les valeurs religieuses, morales et humaines (qui transcendent les lois de la matière et du sensible) du monde, de l’Homme (dans sa vie publique et privée) et de la nature, de sorte que le monde devient une matière relative sans aucune sacralité »[4].
J’ai identifié lors de mes recherches au moins trois résistances à la sécularisation – cette scission aliénante – qui tentent de reconstruire des ponts entre le monde visible (‘âlam ashahâda) et le monde invisible (‘âlam al-ghayb).
La résistance épistémologique à la sécularisation : elle est portée par le grand théologien et philosophe Mohammed Bâqir Assadr, aussi bien dans son œuvre épistémologique que théologique.
Au niveau épistémologique[5], il montre que la foi en Dieu est fondée sur la démarche inductive qui part des faits sensibles et monte en généralité jusqu’à dégager des lois intelligibles, comme la foi en un Créateur de l’univers.
Au niveau théologique, il propose ce qu’il appelle une « exégèse thématique » du Coran qui ne s’isole pas du réel et de l’époque contemporaine.
On voit donc bien que cette vision islamique tente de créer un pont entre le monde visible et le monde invisible, battant en brèche la sécularisation.
Il a à mon sens contribué au renouvellement du kalam devenu chez lui démonstratif en l’articulant à l’épistémologie, rompant par là avec le pessimisme d’Ibn Rushd à propos du kalam réduit chez lui à la dialectique et à l’apologie.
La résistance philosophique à la sécularisation : elle est portée aujourd’hui par le philosophe soufi Taha Abderrahmane.
Il a produit une critique abondante et très subtile de ce qu’il appelle « la misère de la sécularisation » (= « Bu’s ad-Dahrâniyya »)[6], cette séparation de la morale et de la religion, y compris dans les sciences islamiques.
Il est l’un des rares philosophes musulmans, aux côtés de ‘Ali Sâmi An-Nachâr, à accuser Ibn Rushd de promouvoir une philosophie sécularisée en séparant religion et sagesse (=la raison démonstrative d’Aristote).
Il a contribué à une critique de la raison matérialiste et proposé une nouvelle conception de la rationalité inspirée de son expérience spirituelle.
La résistance sociologique à la sécularisation : elle est portée par le sociologue Abdelwahab al-Misayrî.
Il propose une sociologie de la connaissance engagée qui met en lumière ce qu’il appelle « Fiqh at-Tahayyuz », une sociologie de l’inclination intellectuelle qui adopte inconsciemment des schèmes mentaux.
A travers une étude d’un champ très vaste, comme la théologie, la littérature, le genre, l’art, la télévision, les dessins animés, l’urbanisme, la philosophie, le rapport au temps, etc., il a montré qu’ils sont transmetteurs de paradigmes cognitifs, une certaine vision du monde orientée.
On lui doit la distinction entre « ‘almâniyya juz’iyya » (laïcité au sens de séparation du clergé et de l’Etat) et « ‘almâniyya shâmila » (que l’on peut traduire par sécularisation).
Donc, il existe bien une vision islamique fidèle à la tradition musulmane et ouverte sur les défis du monde contemporain.
Quelles idées cette vision peut-elle offrir ? Quelles sont les conditions de possibilité pratiques de l’accomplissement d’une telle utopie ?
L’ijtihâd comme moteur de l’Histoire
Les « idées » qui découlent de la question précédente portent principalement sur l’ijtihad (effort de réflexion) comme moteur continu de l’Histoire et surtout un ijtihâd élargi conformément aux deux sources premières de l’islam, le Coran et la Sunna.
L’ijtihad ne porte pas que sur le fiqh, il porte sur le droit, sur le dogme, y compris sur la philosophie[7].
Je vais développer deux « idées », l’une portant sur la reconsidération de notre conception de l’ijtihad, et l’autre sur les idées concrètes que la vision islamique pourrait offrir dans notre contexte.
Comme l’a bien dit Mohammed Iqbal, « l’islam en tant que mouvement refuse l’ancienne vision statique du cosmos, et adopte une vision dynamique »[8].
Faute d’avoir étudié les « conditions cognitives, intellectuelles, psychologiques et sociales » de son environnement, d’être structurée et représentée, d’avoir une vision islamique au niveau institutionnel, de produire un ijtihad qui porte sur la configuration institutionnelle, bref, faute d’être in fine force de proposition, la communauté musulmane n’a d’autre choix que de réagir sous la passion face aux multiples dénigrements effectifs dont elle fait l’objet.
Le principe de ce dynamisme est l’ijtihâd. « Qu’est-ce que le principe du mouvement de la structure de l’islam, s’interroge-t-il ? c’est ce que l’on appelle « l’ijtihad » »[9].
Mais comment se fait-il que ce principe n’ait pas porté ses fruits dans le lamentable réel des musulmans depuis des siècles ?
Eh bien, au lieu de continuer à se lamenter sur « la fermeture des portes de l’ijtihad », je pense qu’il faut reconsidérer notre conception de l’ijtihad, c’est-à-dire cet effort continu et toujours inachevé d’extraction des prescriptions pratiques et autonomes à partir de leurs sources.
Reconsidérer l’ijtihâd
En effet, pour des raisons politiques et historiques trop longues à expliquer, comme l’a constaté Mohammed Bâqir Sadr, l’ijtihâd s’est mis progressivement à ne concerner que les prescriptions religieuses centrées sur l’individu en tant qu’individu détaché de la Cité.
Non seulement les mujtahidûn sous l’effet du despotisme des gouvernants se sont concentrés sur les ‘ibâdât, un champ qui ne perturbe pas le statut quo du pouvoir tyrannique, mais aussi quant aux mu’âmalât, elles sont restées focalisées sur l’individu négligeant la collectivité en tant que société organisée, susceptible de changements et d’améliorations.
Jusqu’à aujourd’hui, je pense que les musulmans sont héritiers de cet ijtihad amputé et désinstitutionnalisé.
La preuve en est que si je reprends cette belle distinction entre « ijtihâd tarjîhî » (préférentiel) et « ijtihâd ibdâ’î » (créatif) d’un illustre penseur contemporain (cheikh Haydar Hobbollah), je constate que l’on pratique davantage le premier que le deuxième, autrement dit on fouille dans l’histoire du patrimoine musulman pour y trouver des avis marginaux ou occultés jusqu’à présent pour se donner un air de « nouveauté », faire le « buzz » et surtout conforter l’ordre social, alors que l’on attend de nos intellectuels religieux et théologiens de produire un ijtihâd ibdâ’î, c’est-à-dire celui qui porte sur la méthode, c’est là la véritable créativité.
L’ijtihâd au service des défis contemporains
La deuxième « idée » qui découle de la première est l’engagement effectif et réaliste des musulmans dans la construction de la Cité.
Pour que ma réponse ne vous semble pas incantatoire, donnons l’exemple des musulmans de France qui illustre l’absence d’un ijtihâd qui porte sur les musulmans en tant qu’ils font partie d’une collectivité institutionnalisée.
Aujourd’hui, les musulmans semblent vivre des difficultés liées à la présence de l’islam en France et à leur identité musulmane.
Je constate pour ma part que la principale réponse des musulmans s’est jusqu’à présent réduite à la « lutte contre l’islamophobie » sur le terrain juridique.
En tant que citoyens, ils ont raison de mobiliser le droit pour lutter contre les discriminations. Mais se limiter à cette seule voie est inefficace et conduit à une impasse dangereuse.
Pourquoi ? Parce qu’on a réussi à faire en sorte que les musulmans ne se manifestent pour l’essentiel qu’aux moments où ils sont stigmatisés, pour s’indigner.
Auprès de l’opinion publique, les musulmans sont par conséquent perçus comme étant un groupe fermé qui ne fait parler de lui que lorsque ses intérêts particuliers sont affectés, mais on ne l’entend jamais pour des questions qui ne concernent pas l’islam au premier chef, comme les projets de société universels et formalisés à l’instar des programmes des autres partis de la société française.
De ce fait, on peut croire – à tort ! – que les musulmans, ainsi essentialisés, sont une catégorie minoritaire hors enjeux sociaux, individualiste, inutile à la société, car elle ne se manifeste que pour s’indigner sous l’émotion, loin de la pensée sereine et profonde.
Qu’on le veuille ou pas, c’est bien cette représentation de l’islam et des musulmans que certains ont réussi à véhiculer au sein de notre société.
Un groupe religieux qui n’agit que sous l’influence subjective de sa religion, voire de son ethnie.
Cette idée reçue sur les musulmans est d’autant plus accentuée que les réactions émotives de la communauté musulmane abondent.
C’est que, faute d’avoir étudié les « conditions cognitives, intellectuelles, psychologiques et sociales » de son environnement, faute d’être structurée et représentée, faute d’avoir une vision islamique au niveau institutionnel, faute de produire un ijtihad qui porte sur la configuration institutionnelle, bref, faute d’être in fine force de proposition, la communauté musulmane n’a d’autre choix que de réagir sous la passion face aux multiples dénigrements effectifs dont elle fait l’objet, générant par ailleurs un appel ridicule à « l’invisibilité ».
Il est urgent de sortir de ce piège, il en va de notre cohésion sociale !
Mouhib Jaroui
Notes :
[1] Sourate Arra’d, 11.
[2] Mohammed Hussein Fadlallah, Min Wahyi al-Qurâne.
[3] Mohammed ‘Abed al-jâbirî, Al-‘aql al-akhlâqî al-‘arabî, 2001, 7ème éd. 2016, p. 592, chez markaz dirâssât al-wahda al-‘arabiyya.
[4] Abdelwahhab al-misayrî, al-‘almâniyya tahta al-majhar, 2000, 4ème éd., 2014, p. 122.
[5] Mohammed Bâqir Sadr, al-usus al-mantiqiyya lilistiqrâ’.
[6] Taha Abderrahmane, Bu’s ad-Dahrâniyya, an-Naqd al-itimânî lifasli al-akhlâq ‘ani ad-Dîn, 2014.
[7] Zaki al-milâd parle même de « al-ijtihâd al-falsafî » dans son ouvrage « Madkhal ilâ al-masala al-falsafiyya », 2017, p. 36.
[8] Mohammed Iqbâl, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p. 243.
[9] Mohammed Iqbâl, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p. 246.