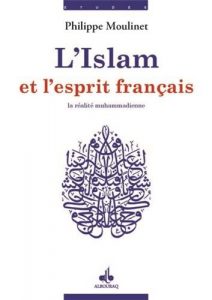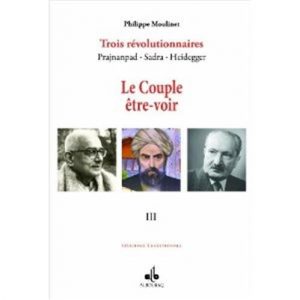« À l’aube de la pensée (qu’elle soit orientale ou occidentale) il y a cette grande intuition que l’être et le connaître font un » écrit Philippe Moulinet dans un texte, extrait de son livre Islam et esprit français, dans lequel il explore les rapports profonds entre le sujet et la possibilité de connaître.
Ouvrir un livre c’est s’ouvrir soi. Ce geste est chargé d’ambivalence : il y a l’espoir de découvrir du sens, et aussi le pressentiment qu’aucune réponse « du dehors » ne pourra nous satisfaire, c’est-à-dire nous révéler à nous-mêmes. Il y a en nous une aspiration à obtenir un savoir unitaire, complet. Dieu répond à notre besoin : « Aujourd’hui j’ai rendu votre religion complète et mis le comble à mes bienfaits » (Coran, 5 : 5). Mais la plupart du temps nous ne sommes pas au rendez-vous pour jouir du don divin. Nous cherchons des réponses sans être bien au clair sur les questions. Nous voulons le mot de la fin mais nous ne savons par où commencer. Au commencement de toute recherche il y a comme un malaise, voire une espèce d’angoisse, parce que nous discernons mal l’objet de la recherche, et, du coup, nous attendons de celui qui parle qu’il définisse pour nous le champ d’investigation. Si nous continuons sur ce chemin, nous arrivons à une impasse. Car la question n’est pas de savoir : « par où commencer » mais « par qui » ? Nous ne cherchons pas un objet à appréhender mais un sujet à comprendre. Souvenons-nous de l’injonction grecque : « connais-toi toi-même » ; on la retrouve dans le hadith : « qui connaît son âme connaît son Seigneur. » Celui qui arrive à connaître « soi », « je », connaît toutes choses. C’est la seule manière de s’y prendre pour, aujourd’hui, se sentir complet.
La mise à l’écart épistémique du sujet
Voilà tout le drame de la connaissance : nous nous intéressons à l’objet et faisons l’impasse sur le sujet, comme s’il était absent. Nous nous prenons nous-mêmes pour un fait acquis, habituel, que nous pouvons oublier comme une chose banale, comme si le nouveau, l’intéressant ne pouvait venir que du dehors. Nous laissons se déployer devant le regard de notre esprit le jeu des questions et des réponses, mais celui qui pose la question ne semble pas concerné par la réponse. Comme si nous n’étions pas intéressés à l’affaire. C’est un simple jeu verbal qui se produit à la surface de nous-mêmes.
Nous disons par exemple : « en ce moment c’est la crise en Europe, il y a même une crise mondiale ». Mais en réalité il n’y a pas « la crise », il n’y a que moi disant « il y a une crise mondiale ». Il n’y a que moi ressentant et éprouvant les effets de cette crise sur moi, sur ma vie quotidienne. Et j’espère vous montrer dans ce livre que c’est cette manière de questionner, celle qui oublie la moitié de la phrase, celle qui pratique l’ablation du sujet, qui est responsable de la crise actuelle.
Cette manière de s’interroger évacue le sujet comme chose de peu d’importance. « Je » est tenu pour un fait acquis, un fait accompli, bien connu et assuré. Et la recherche doit porter sur le dehors. Nous sommes tellement habitués à nous-mêmes que nous nous oublions ; nous cherchons un fondement à l’extérieur, dans le connu, dans le réel installé « en soi », hors de nous. C’est un savoir stérile : « N’as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour divinité et que Dieu égare en dépit de sa science ? » (Coran, 45 : 23).
Bref, je me traite comme une abstraction et je place toute la réalité de l’autre côté, du côté de l’objet, dans le monde, qui restera là quand nous aurons disparu. Je suis en perpétuelle hémorragie.
Nous ne nous étonnons pas d’être, d’être un homme, une femme capable de connaître, de sentir, de se rencontrer comme un soi. C’est pourtant un grand mystère : je connais des choses concrètes, des événements, tout ce qui arrive, je connais aussi des choses subtiles, des sentiments, des émotions esthétiques, intellectuelles. Et dans toutes ces modifications, je reste la même personne. Sans cette personne il n’y a aucune perception possible. Si je n’étais pas d’abord révélé à moi-même comme cette personne ici, vivante, je ne pourrais m’intéresser à rien, et rien n’existerait. Qu’est-ce qui resterait de moi-même faisant ceci ou cela, marchant dans la rue pour aller chercher du pain ou parlant dans ce micro, si je n’étais pas révélé à moi-même, directement, immédiatement, par voie de conscience ? Rien. Le grand mystère à creuser c’est le mystère par lequel mon être personnel s’apparaît à lui-même. Disons que c’est le mystère de l’esprit.
Connaître l’amour, c’est aimer
À l’aube de la pensée (qu’elle soit orientale ou occidentale) il y a cette grande intuition que l’être et le connaître font un. Aristote nous répète qu’un être est tout ce qu’il connaît. Il n’y a de connaissance véritable que là où se réalise l’identification de l’objet au sujet. Si bien qu’en réalité nous ne connaissons jamais que nous-mêmes. Connaître le feu, par exemple, c’est avoir touché le feu, être devenu feu soi-même. Quand on veut certifier la validité d’un fait, on dit : « j’en mettrais ma main au feu ». Connaître l’amour c’est être amoureux, tomber amoureux soi-même, éprouver ce sentiment en soi. Cela me fait penser à ce jeune homme qui demandait à un ami, plus âgé et expérimenté : « est-ce que tu crois que je suis amoureux de cette fille ? » Il cherche en dehors de lui une preuve de ce qu’il est seul à pouvoir éprouver en lui-même.

Quand on veut prendre des exemples un peu crus, on est obligé de s’abriter derrière la tradition. Sohrawardi dit : « Si un homme qui n’a pas encore atteint l’âge viril, s’approche d’une femme, cela ne provoque en lui aucune jouissance. Mais, lorsqu’il a atteint la virilité et est en souci du contact d’une femme, ce contact éveille en lui un tel plaisir que si, au moment de consommer l’acte d’amour, l’un de ses plus chers amis venait l’en empêcher, il regarderait celui-ci comme son pire ennemi, alors qu’il se perd dans ce plaisir. Mais, à supposer qu’il veuille faire à un impuissant le récit du plaisir éprouvé dans cet état, l’impuissant ne comprendra rien à son récit, parce que l’on ne peut comprendre ce qu’est en réalité un état de plaisir, qu’à la condition de l’avoir éprouvé soi-même. Or, cette chance est interdite à l’impuissant. »
Eh bien notre connaissance conventionnelle, celle que nous pratiquons au quotidien, est frappée d’impuissance. Elle n’est pas féconde, vivante, parce qu’elle repose sur le divorce du connaître et de l’être. Il nous semble que notre connaître réside à l’intérieur de nous, sous forme de pensées, d’images mentales, de représentations, de paroles, et que l’être ou le réel résident à l’extérieur, dans le monde, dans les choses vues qui ont leur réalité à part, qui vivent leur vie sans nous. Il me semble que « moi » qui questionne, qui pense, je suis en dehors de l’être, de la vie qui n’appartient qu’au monde des choses. Je me mets à chaque fois hors-jeu. Je m’expulse du cœur de la vie, je m’extrais de l’être, et je confère à la réalité objective toute la charge d’existence, m’accordant juste assez d’existence pour savoir que je suis mortel, ce qui n’est pas un sort très enviable. Je suis comme le dit Heidegger un « être pour la mort ».
Le rêve de Sohrawardi
La connaissance, dans l’état habituel de conscience, fonctionne sur la scission, la coupure entre le moi et le non-moi. Il y a moi ici / rupture / et loin là-bas il y a le non-moi. Ce schéma perceptif là constitue la Chute : l’illusion que la connaissance existe en dehors de moi. L’expulsion du Paradis, c’est être hors de soi. Non seulement la chose connue semble se tenir à distance, dans un monde extérieur, étranger, mais même la connaissance que j’en ai semble être devant moi sous formes de représentations. Le moi qui connaît semble lui aussi susceptible de faire l’objet d’une investigation, d’être placé devant, sous le regard. C’est ce qu’on appelle l’introspection. On s’observe soi-même en se tenant à distance, au moyen d’une loupe ou d’un télescope, pour grossir et observer nos mouvements intérieurs. Et si l’on s’adresse à Dieu on Le pense aussi à distance, comme une réalité indépendante de nous, transcendante.
Une vraie religion réalise l’union de l’être et du connaître, elle nous réunit à nous-mêmes. « Nous avons fait descendre vers vous un Livre où se trouve le Rappel à vous-même » (Coran, 21 : 10). La religion, il faut qu’elle nous fasse sentir que la réalité est en nous, pas hors de nous. Nous sommes des connaissant, nous n’avons pas connaissance. Il faut avant tout commencer par s’intéresser à nous-mêmes, à sonder ce qui est nous. Inter-esse est le mot qui convient : être entre soi et soi.
C’est le leitmotiv de toutes les religions. Le Christ dit : « Que sert-il à l’homme de gagner le monde entier s’il vient à perdre sa propre âme ? » (Mathieu XVI, 26).
Sohrawardi, alors que le problème de la connaissance l’assaillait de difficultés insolubles rencontre Aristote en songe qui lui dit : « Reviens, éveille-toi à toi-même et le problème se résoudra pour toi. Comment cela ? dis-je. La connaissance que tu as de toi-même par toi-même, est-ce une perception directe que tu as de toi-même par toi-même, ou bien que tu dois à quelque chose d’autre… Cette voie consiste pour le chercheur à enquêter tout d’abord sur sa connaissance de soi-même, pour s’élever ensuite à la connaissance de ce qui est au-dessus de lui ».
Un autre exemple de relation d’éveil nous est donné par le grec ‘Amalaq qui interroge son maître Qosta ibn Lûqâ : « ne me feras tu pas connaître mon Dieu de sorte que je ne m’approche que de Lui et ne prenne refuge qu’en Lui ? La Sage lui dit : connais-tu celui qui te fait connaître toi-même (nafsaka, ton anima) à toi-même ? »
Le sujet comprend l’univers
Le grand mystère est celui-là : je suis révélé à moi-même. Je peux dire « je ». Quelle que soit la situation où je me trouve, quelle que soit la chose ou la personne avec qui je suis, je ne peux établir une relation que sur la base de cette première révélation : « je ». Mon être profond s’apparaît à lui-même, est révélé à lui-même, se sent présent. Nous ne pratiquons pas l’absentéisme intérieur. C’est ce que nous appelons la présence d’esprit. Et cette présence reste elle-même dans toutes les choses variées avec lesquelles elle fait connaissance. La connaissance de soi est l’axe autour duquel tournent toutes les autres connaissances. Le propre de l’homme c’est de pouvoir dire « je », d’être doué de personnalité. Un animal peut se sentir vivre, mais il ne peut pas se saisir, s’appeler lui-même en disant « je ».
Le « je » est un phénomène complètement non naturel, non mondain. Simone Weil dit dans le recueil La pesanteur et la Grâce : « Nous ne possédons rien au monde – car le hasard peut tout nous ôter – sinon le pouvoir de dire je… Rien au monde ne peut nous enlever le pouvoir de dire je ».
Cela nous rappelle Pascal : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien… par l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends. »
Philippe Moulinet
A lire aussi :