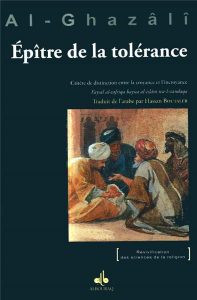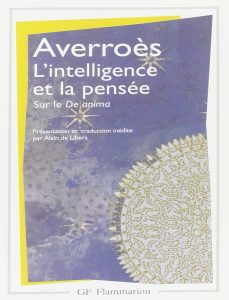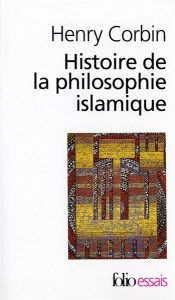Mizane.info publie la seconde partie de l’article de Daoud Riffi consacré à la déconstruction du mythe de la fermeture des portes de l’ijtihad. Dans ce volet, l’auteur indique les différents acteurs contemporains (orientalisme, salafisme) qui ont contribué à la diffusion de ce mythe et souligne dans quelles circonstances historiques ce travail a été accompli. Daoud Riffi est professeur agrégé et chercheur en histoire du monde arabe.
En s’appuyant sur les travaux des juristes anciens et les faits historiques, la première partie de mon étude révisait l’idée que « les portes de l’ijtihâd » aient pu être fermées au 9e siècle.
Cette seconde partie reviendra sur l’historique de cette légende de « fermeture », et sur ses implications.
Intimement liée aux travaux orientalistes du 19e siècle et aux idées de la salafiyya, les notions de « fermeture » et de sclérose de la pensée sont aussi le reflet du complexe intellectuel d’un monde musulman qui ne perçoit plus l’intellectualité qu’à travers le prisme de la pensée moderne.
1 – La légende de la « fermeture »
Dès le début de cette étude j’ai défini la « fermeture de l’ijtihâd » comme une légende, au sens étymologique ; du latin legenda : « ce qui doit être lu », c’est-à-dire : ce qui donne sens à quelque chose.
Considérer que les portes de l’ijtihâd ont été fermées a en effet offert, à ceux qui ont défendu cette idée, une vision rétrospective commode du passé islamique, qui leur permettaient de jeter un discrédit global sur celui-ci. Mais c’est également une légende au sens courant du mot : « représentation d’un fait, d’un événement historique, déformé par l’imagination ».
« Le thème de la fermeture de la porte de l’ijtihâd, note É. Chaumont (2004), apparaît en Occident dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle chez des orientalistes comme L. Ostrorog ou L. E. Brown et il trouvera enfin sa formulation canonique, en 1964, chez J. Schacht ».
J’ai relevé en première partie qu’une série de confusions dans l’histoire intellectuelle de l’Islam est une des causes de ce mythe. L’autre cause est quant à elle à chercher dans l’histoire intellectuel du 19e siècle, en Europe comme dans le monde musulman : la consécration d’une pensée moderne qui ne voit d’autre raison que le rationalisme, d’autre science que la technique, et d’autre perspective historique que le positivisme et le progressisme.
Ces idées, aussi naïves qu’elles puissent nous apparaître aujourd’hui, dominèrent des décennies durant l’orientalisme et marqueront durablement les intellectuels de la Nahda, de la salafiyya et, in fine, de la plupart des musulmans.

Elles sont les ferments d’une vision historique méprisant la période classique de l’Islam (9e-18e siècle) car jugée arriérée par comparaison à la « révolution scientifique » européenne[1].
Elles sont la cause du préjugé moderne contre la production intellectuelle islamique, pourtant très riche, des siècles précédents, de la même manière que la Renaissance européenne et les philosophes des Lumières jetteront longtemps le discrédit sur le Moyen Âge. On pense alors le passé comme une période inféconde car ne correspondant pas aux attendus que la vision moderne pense comme seuls dignes. Les œuvres fondamentales de l’islamologue, historien des sciences et philosophe Seyyed Hossein Nasr, et de son élève William Chittick, ont réservé un sort à ces préjugés[2].
L’historien des idées constate que, sur plusieurs points, orientalistes des mi-19e/début 20e siècle et penseurs de la Nahda puis de la Salafiyya vont s’alimenter mutuellement dans une sorte de cercle vicieux : les uns inspirent les autres, et inversement, nourris réciproquement par une série de préjugés, colonialistes, scientistes, matérialistes … la pensée moderne, critique de la tradition classique et fascinée par l’idée de Progrès de l’histoire, est au cœur du regard rétrospectif sur le passé islamique qu’ont en commun orientalistes et intellectuels arabes[3].
Les notions de « fermeture », « sclérose » ou « déclin » intellectuels, mais aussi de « retour aux Sources » et de salafiyya sont des exemples frappants de cette dialectique orientalisme/salafiyya, comme de récentes études l’ont bien montré[4]. Éric Chaumont note pertinemment que « la plupart des représentations issues de l’orientalisme classique se sont imposées auprès des musulmans eux-mêmes. En réalité, la critique musulmane à l’endroit des orientalistes, al-mustashriqûna, est aussi virulente qu’est massive l’adoption par les élites musulmanes des thèses développées au sein de l’orientalisme et l’ijtihâd ne fait pas exception à la règle ».
A lire du même auteur : « Rouvrir les portes de l’ijtihâd » pour sortir de la sclérose intellectuelle : histoire d’un mythe orientaliste et salafi 1/2
De même El-Rouayheb relève, en conclusion d’un livre montrant de manière magistrale que les sciences intellectuelles furent vivantes jusqu’à la fin de l’Empire ottoman :
« Une grande attention a été accordée au cours des dernières décennies à la question de ‘l’orientalisme’ et à la manière dont les savants occidentaux ont construit une image tendancieuse de l’histoire islamique. Les observations qui précèdent indiquent un courant d’influence qui a reçu beaucoup moins d’attention et qui coule dans la direction opposée : la manière dont la recherche occidentale sur l’histoire intellectuelle islamique reflète les tendances contemporaines du monde islamique et hérite des récits historiques partisans de ces tendances contemporaines […] Il ne s’agit bien sûr pas de nier que les chercheurs occidentaux ont parfois été poussés par leurs propres préjugés lorsqu’ils écrivent sur l’islam et l’histoire de l’islam. Mais ce ne sont clairement pas seulement les « orientalistes » qui ont construit des récits historiques partisans et intéressés ; il en va de même pour les ‘réformateurs’ et ‘revivalistes’ musulmans, les nationalistes arabes, les théosophes iraniens modernes et les kémalistes turcs. » [5]
Par leur vision décliniste – avec ijtihâd « fermé » depuis le 9e siècle – les penseurs de la Salafiyya vont créer une généalogie intellectuelle imaginaire, dans laquelle l’histoire de la pensée islamique va être résumée à quelques figures, censées avoir porté seules – et contre tous – la vigueur de l’ijtihâd : Ibn Taymiyya ; Ibn Abdal Wahhâb (fondateur éponyme du wahhabisme, m. 1792) ; Shawkânî ; Afghânî (m. 1897) et son élève ‘Abduh (m. 1905).
Quelques noms, auxquels s’ajoutent de rares autres, présentés comme des oasis de pensée dynamique dans un désert de conformisme intellectuel. Cette généalogie imaginaire et cette histoire mythique se retrouvent y compris dans toute une littérature francophone, de facture parfois universitaire, en particulier chez des auteurs issus des rangs de la pensée « réformiste ». En témoigne par exemple le livre de Tariq Ramadan, Aux sources du renouveau musulman (1996) : parfaite illustration de ces types de généalogie et d’histoire, il inscrit ainsi Ibn Abdal Wahhâb dans le sillage de ce qu’il considère comme une lignée de mujaddid-s, d’Ibn Taymiyya à Ḥassan al-Banna, en passant par Afghânî et ‘Abduh.

De même Rachid Benzine, disciple de Mohamed Arkoun, voit-il dans la pensée et les actions d’Ibn ‘Abdal Wahhâb les prémisses de ces « nouveaux penseurs de l’islam » qu’il met en avant. Ibn ‘Abd al-Wahhâb, affirme-t-il, « a insufflé un vrai mouvement de réforme dans l’islam arabe décadent, et tous les mouvements de revivalisme islamique qui sont apparus depuis font plus ou moins référence à sa pensée, y compris Afghânî et M. ‘Abduh » [6].
L’imam et penseur Tareq Oubrou, enfin, particulièrement intéressé par ces questions, livre lui aussi une vision caricaturale de la pensée juridique islamique, présentée comme stérilisée par le conformisme, « l’imitation aveugle » et la culture de la glose[7] :
« Si la fermeture de l’ijtihâd a pu résoudre le problème de l’excès normatif, elle en a créé un autre : celui du fanatisme. Chez les canonistes, la culture du pluralisme a cédé la place à une attitude plus sectaire. Ils se contentaient désormais de commenter les textes juridiques de leur école comme des textes divins, selon une logique scolastique fermée et apologétique. On a parlé à ce propos d’une « culture des marges », parce qu’il s’agissait de commentaires faits en marge des textes de droit classique. On pouvait ainsi trouver dans un même ouvrage trois marges ou plus : le commentaire du texte initial – souvent celui d’un grand maître canoniste d’une des écoles établies –, le commentaire du commentaire, le commentaire du commentaire du commentaire, et ainsi de suite. C’est ainsi que l’esprit du droit s’est perdu dans les marges et s’est retrouvé décalé par rapport à des sociétés musulmanes qui, elles, étaient travaillées en profondeur par la modernité et la sécularisation. » [8]
Autant de visions, héritées des penseurs réformistes nous l’avons dit, ne correspondant donc en rien avec une réalité historique infiniment plus complexe. A. Dallal, dans son travail fondamental sur la pensée juridique du 18e siècle, a montré comment l’ijtihâd n’a cessé d’être dynamique et qu’une figure comme Shawkânî, vanté donc comme mujtahid quasi solitaire par la salafiyya, s’inscrivait en fait dans une longue tradition encore vivace.

Davantage : El-Rouyaheb relève même que jusqu’au 19e siècle cet ijtihâd s’étendait au-delà de la seule jurisprudence, touchant le credo, condamnant le taqlîd y compris dans ce domaine.
C’est au contraire le 19e siècle finissant, magnifié comme période de « renaissance » qui va réduire la portée de l’ijtihâd, non les siècles le précédant.
Ces visions relèvent en réalité d’une récréation littéraire et idéologique, née au 19e siècle, à cheval donc entre orientalisme condescendant et salafiyya cherchant à magnifier ce qui devait venir après le déclin, c’est-à-dire eux-mêmes.
On est bien là, au sens propre, en pleine légende : « représentation d’un événement historique, déformé par l’imagination » et ce qui « doit être lu » ; dans le cas qui nous intéresse ici : comment doit être lu le passé islamique.
Ainsi les intellectuels réformistes ont-ils dépeints les siècles passés de la même manière que l’Occident moderne traita le Moyen Âge : comme une période inféconde, intellectuellement dépendante des générations plus anciennes[9] et, pour les musulmans, incapable d’assumer le nécessaire ijtihâd[10]. Le sauveur est alors tout désigné : la salafiyya, qui offre ses moyens de réformes religieuses et socio- politiques. C’est cela qu’il faut comprendre dans la légende de la « fermeture » et du déclin.
2- Le mythe du déclin, révélateur de la fin de l’intellectualité islamique
On l’a vu : le mythe de la « fermeture » est intimement lié à l’idée que l’ijtihâd restauré serait la condition sine qua non du dynamisme intellectuel ; l’inverse expliquerait le « déclin ». La vision fantasmée de l’ijtihâd pose ce premier problème : on le prend pour ce qu’il n’est pas.
Ce qu’il est : une obligation légale permettant de gérer les interprétations et les divergences qu’elles impliquent. Et rappelons ce que l’histoire nous montre de manière évidente : le recours à l’ijtihâd est, très exactement, ce que revendiquent tous les courants du wahhabisme, à commencer par Ibn Abdal Wahhâb lui-même.
Et c’est au nom de cet ijtihâd que l’excommunication (takfîr) et le meurtre des musulmans – restés attachés aux Écoles – furent possibles. Invoquer l’ijtihâd comme la clef qui délivre est donc un raccourci…
De tout ce qui précède nous en arrivons au fond du problème, qui relève de l’histoire des idées : la question de l’épaisseur intellectuelle de la période classique (9e-18e siècle) et de la nature et de la qualité du savoir qui s’y est transmis.
Je l’ai relevé à plusieurs reprises : cette période, censée succéder à la « fermeture », est perçue par le « premier orientalisme » et les intellectuels arabes comme une période de déclin intellectuel, à tous niveaux.
Cette idée fut si répandue, pendant si longtemps, que les chercheurs – qui ont depuis plusieurs décennies ruiné ce mythe – parlent de « paradigme du déclin ». Dans un long article, C. Mayeur-Jaouen (2018) a livré en quelques dizaines de pages passionnantes un résumé de vingt ans d’islamologie/historiographie.
Elle y passe en revue quelques grands mythes hérités des 19e-20e siècle et montre comment les chercheurs des dernières décennies, par leurs multiples monographies et études, ont remis entièrement en question le paradigme du déclin pour offrir un tableau beaucoup plus riche et varié.
Un des apports majeurs de la recherche récente étant qu’elle redonne aux divers centres intellectuels du monde musulman (Maghreb, Afrique, Orient non arabe, Asie, etc.) tout leur dynamisme et leur profondeur intellectuelle, à des années lumières du tableau laissé par les intellectuels des mi-19e/mi-20e dont j’ai parlé ici.
De fait, comme le souligne l’historien américain A. Dallal (2018), on a très injustement considéré que les oulémas et intellectuels inscrit dans la famille large (et mal nommée) de la salafiyya furent les pionniers d’un mouvement de renouveau intellectuel.
La réalité historique montre plutôt l’inverse : les mouvements de réforme – celui d’Ibn ‘Abd al-Wahhâb au 18e siècle, puis des intellectuels en Égypte et Syrie cités plus haut – ont davantage stoppé des possibilités d’une « autre modernité ».

C’est toute la thèse soutenue par S. Akkach (2007), dans une stimulante biographie d’une figure centrale des 17-18e siècles, trop oubliée aujourd’hui : ‘Abd al-Ghanî Al-Nâbulusî (m. 1731).
Akkach évoque ainsi ces « autres Lumières » manquées du monde musulman, marquées par une grande richesse intellectuelle – on se transmet alors dans l’Empire ottoman, en sus du ḥadîth du fiqh, des sciences rationnelles et intellectuelles d’une grande variété – différentes du rationalisme qui va bientôt dominer l’Europe et subjuguer l’Orient, ouvrant une autre voie à la raison.
Une autre grande figure, tout aussi centrale, avait été révélée au lectorat anglophone par S. Reichmuth (2009) : Murtaḍâ al–Zabîdî (m. 1790).
Ce polymathe (à la fois muḥaddîth, juriste, lexicographe et héritier de la métaphysique d’Ibn ‘Arabî), fut célèbre pour son considérable commentaire de l’Iḥya d’Al-Ghazâlî[11] et pour son immense dictionnaire encyclopédique (Tâj al-‘Arûs), témoignage, s’il en fallait, de la vigueur intellectuelle de ces savants occultés par l’imaginaire historique propagé par la salafiyya.
Dallal le rappelle pourtant : ces grands esprits, sans être majoritaires à leur époque – et comment cela pourrait-il être possible ? – étaient de leur vivant même considérés comme les références incontournables.
Ils n’étaient pas seuls contre tous[12]. J’ai cité à plusieurs reprises les travaux majeurs de Dallal et de Rouayheb. Ce dernier a livré une somme historique, avec plusieurs études de cas régionales, illustrant de manière concrète ce que William Chittick énoncé déjà dans son recueil de conférences sur la cosmologie islamique (2007), déjà cité.
En effet, Chittick démontrait brillamment que le monde musulman avait en grande partie perdu la compréhension de son héritage intellectuel, aussi bien rationnel que métaphysique, et ne comprenait plus même la notion d’intellectualité.
En cause, relevait-il, la fascination des penseurs musulmans pour les sciences et techniques modernes et leur mépris pour la grande tradition intellectuelle de l’islam classique. Chittick montrait également comment certains mots avaient perdu de leur profondeur depuis le 19e siècle, pour n’être réduits qu’à quelques sens secondaires : en particulier ijtihâd et taqlîd justement, mais aussi « vérification » (taḥqîq), notion centrale dans l’idée d’intellectualité[13].
El-Rouayheb est revenu sur ces questions, pour en livrer des exemples historiques concrets, s’appuyant notamment sur les cas maghrébins et kurdes au 17e siècle[14], en particulier de grands logiciens.
Il montre ainsi qu’il y avait une tradition particulièrement vivace d’étude de la philosophie et des sciences rationnelles dans l’Empire ottoman alors, reflétée, entre autres, par « l’augmentation spectaculaire du nombre et de la longueur des écrits ottomans sur âdâb al-baḥth (discussions de dialectique et de logique) » et l’émergence d’un « idéal nouvellement articulé de l’acquisition de connaissances par la lecture approfondie ».
Autre caractéristique de cette époque : « un enthousiasme pour la logique (manṭiq) et une utilisation extensive des concepts logiques et des formes d’argumentation dans le domaine de la théologie rationnelle ».
Rouayheb révèle ainsi une effervescence intellectuelle favorisée par l’installation, au cœur de l’Empire, de savants venant du Maghreb et du Kurdistan actuel, amenant avec eux toute une tradition rationnelle et scientifique (dont l’astronomie).
Mais la remise en cause du déclin et de la « fermeture » va au-delà. Non seulement l’ijtihâd n’a cessé d’exister, mais en plus il n’était en réalité pas cantonné aux seules sphères juridiques : « La ‘stagnation’ et le ‘déclin’ de l’histoire intellectuelle islamique a eu tendance à être inutilement associée au développement (ou au manque de développement) de la loi islamique et en particulier à la question de l’ijtihâd – si la porte de l’ijtihâd’ était fermée ou restée ouverte (ou au moins légèrement entrouverte). Cette focalisation […] tend à éluder la centralité de l’idéal de ‘vérification’ (taḥqîq) pour la culture savante islamique prémoderne. Pour dire les choses franchement, l’ijtihâd – la dérivation de décisions juridiques directement à partir des sources reconnues de la loi islamique sans qu’il y ait un précédent juridique – n’avait peu ou pas d’importance pour les logiciens, dialecticiens, mathématiciens, astronomes, grammairiens, théologiens, philosophes, et mystiques. Même si l’on supposait, pour le bien de l’argumentation, que la ‘ porte de l’ijtihâd’ était en fait fermée, cela ne nous apprendrait rien sur le dynamisme ou la stagnation des domaines non légaux de l’érudition islamique. »[15]
Non seulement Rouayheb et Chittick montrent que le déclin intellectuel est une fiction conjointe de l’orientalisme, de la Nahda, de la salafiyya (ils le répètent à plusieurs reprises), mais ils rappellent ainsi que l’horizon de la pensée islamique était bien plus large que la seule jurisprudence islamique, à laquelle on accorde une place disproportionnée. La fiction du déclin est donc révélatrice d’autre chose : de l’ignorance de l’histoire de la pensée islamique d’une part, et de l’incapacité à la comprendre d’autre part.
Ce dernier point dessine, en creux, quelque chose de plus profond, brillamment démontré par Chittick : que les penseurs jugeant l’histoire islamique à l’aune de l’évolution de la science occidentale prouvent par là-même qu’ils ne savent plus ce qu’est la véritable intellectualité…
Dans les débats sur l’islam contemporain, les intervenants ne sont plus les mêmes : pendant des siècles les oulémas étaient les seules références compétentes ; puis, à partir de la fin du 19e siècle, les intellectuels s’invitèrent dans les discussions théologiques et socio-politiques. Historiens et islamologues sont désormais convoqués, faisant partie intégrante du paysage intellectuel dans lequel se discutent les idées, devenant ainsi une source de connaissance de l’histoire de la pensée islamique.
On a pu entrevoir ici le paradoxe : c’est aujourd’hui dans le cadre de la recherche universitaire que les réalités autrefois connues des seuls cercles savants, mais occultées par un siècle et demi de « réformisme islamique », finissent par réapparaître.
Et c’est sans doute là que se trouve le véritable enjeu des musulmans d’aujourd’hui : dans les débats parfois houleux dans lesquels ils sont mêlés, bon gré mal gré, il s’agit peut-être moins de chercher des réponses inédites via un ijtihâd fantasmé (et par bien des aspects imaginaires), que de redécouvrir l’immensité de leur patrimoine intellectuel classique, qui pourrait offrir bien des réponses aux défis nouveaux, et universels, de notre « postmodernité ».
Daoud Riffi
Notes :
[1] Sur le mythe de la « révolution scientifique », voir Steven Shapin, La Révolution scientifique, Flammarion, 1998.
[2] Pour Nasr, dont l’œuvre pléthorique ne se prête pas aux résumés faciles, en plus des nombreux travaux qu’il a consacrés à l’histoire de la philosophie (notamment avec H. Corbin) et des sciences islamiques, on peut se reporter à La Connaissance et le Sacré (L’Âge d’Homme, 1981) pour avoir une vision de la notion d’intellectualité, dans une perspective historiquement universelle. Le livre de Chittick (2007, à paraître, éditions Tasnîm, 2021), Science of the Cosmos, Science of the Soul : The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World, apparaît comme fondateur pour les recherches en cours sur les notions de taqlîd, ijtihâd et taḥqîq, que poursuivra, sous une autre forme, El-Rouayheb.
[3] Voir Chaumont (2004), qui résume bien ces idées.
[4] Voir El-Rouyaheb, 2015, en particulier ses introduction et conclusion. Pour la notion de salafisme, qui va connaître une forme de va-et-vient entre intellectuels musulmans (notamment Rashîd Riḍâ) et orientalistes, pour devenir la notion complexe, mais largement anhistorique et décontextualisée qu’elle est devenue ensuite, voir la passionnante étude d’Henri Lauzière, 2015.
[5] El-Rouayheb, (2015), p. 359-361.
[6] Rachid Benzine (2004), p. 37.
[7] Sans entrer dans des détails qui forceraient à des digressions importantes, relevons cependant que cette critique de la « culture des marges » est un autre préjugé moderne, renvoyant ce type d’écrits dans les abîmes du taqlîd, à l’opposé d’une pensée se voulant dynamique et autonome. Cette vision caricaturale est remise en cause par la recherche récente qui montre que la glose est un genre littéraire à part entière, bien éloigné du taqlîd (lui-même conçu de manière erronée comme du suivisme aveugle), et doté de sa propre richesse (Voir notamment les travaux de Robert Wisnosky). Préjugé moderne : car on confond singularité et dynamisme, et on ne voit de qualité que dans « l’absolument nouveau ». (Tous mes remerciements à G. Vandamme qui m’a orienté sur ce point).
[8] Tareq Oubrou (2016), p. 73.
[9] L’Antiquité pour la Renaissance européenne ; les trois premiers siècles pour les réformistes.
[10] Les historiens ont réservé un sort au mythe d’un sombre Moyen Âge européen. Les travaux de Jacques Le Goff, mais aussi de Michel Pastoureau, par exemple, ont montré toute l’ampleur de l’injustice faite envers une période immensément riche.
[11] Voir la première partie de cet article
[12] En introduction à son histoire intellectuelle du dix-septième siècle (2015, p. 5), Rouyaheb met lui aussi en garde contre une méprise concernant les multiples figures savantes qu’il présente : « mon objectif a été de les présenter en tant que représentants de tendances intellectuelles plus larges au sein de la classe des oulémas à leur époque, et non en tant que figures héroïques qui ont réussi d’une manière ou d’une autre à se démarquer dans un siècle par ailleurs sombre ».
[13] Il est impossible de résumer ici la richesse et la singularité des propos de Chittick, qu’a poursuivis El-Rouayheb à partir de cas concrets puisés dans l’Occident et l’Orient islamiques du 17e siècle. Je ne puis que renvoyer le lecteur au livre qui doit paraître en français.
[14] La permanence de l’école kurde de sciences rationnelles en Syrie a trouvé tout récemment une actualité, avec le décès en mai 2020 du Cheikh Mullâ Yûsuf al-Bâsiqlî, qui transmettait ce savoir rationnel pluriséculaire. El-Rouayheb (p. 56) relève également que le dernier Shaykh al-Islâm ottoman, Zahîd al-Kawtharî (m. 1951), était l’héritier dans ces sciences, par chaîne de transmission directe (isnâd), des maîtres perses du 15e siècle.
[15] Rouayheb (2015), p. 7-8.
Bibliographie
– Akkach, Samer (2007), ‘Abd al-Ghani al-Nabulusi: Islam and the Enlightenment, One World
– Baljon, Johannes Marinus Simon (1986) Religion and Thought of Shâh Walî Allâh Dihlawî, 1703–1762, Brill.
– Benzine, Rachid (2004) Les Nouveaux penseurs de l’islam, Albin Michel.
– Chaumont, Éric (2004), « Quelques réflexions sur l’actualité de l’ijtihâd », in Lectures contemporaines du droit islamique, Presses Universitaires de Strasbourg, p. 71-79.
– Chittick William (2007) (à paraître, éditions Tasnîm, 2021), Science of the Cosmos, Science of the Soul : The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World, One World Publications.
– Chouiref, Tayeb (2020), Soufisme et hadith dans l’Egypte ottomane ; Abd al-Ra‘uf al-Munawi (952/1545 – 1031/1622), IFAO.
– Dupont, Anne-Laure, Mayeur-Jaouen Catherine (2016), Histoire du Moyen-Orient, Armand Colin.
– El-Rouayheb, Khaled (2015), Islamic intellectual history in the Seventeenth Century : Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb, Cambridge University Press.
– Hallaq, Wael (1984), « Was the Gate of Ijtihâd Closed? », International Journal of Middle East Studies, Vol. 16, No. 1 (Mar., 1984), pp. 3-41.
– Lauzière, Henri (2015), The Making of Salafism. Islamic Reform in the Twentieth Century, Columbia University Press.
– Mayeur-Jaouen, Catherine (2018), « À la poursuite de la réforme : renouveaux et débats historiographiques de l’histoire religieuse et intellectuelle de l’islam, XVᵉ‒XXIᵉ siècle », Annales. Histoire, sciences sociales, 2018, 73/2, pages 317‒358.
– Nasr, Seyyed Hossein (1981), La Connaissance et le Sacré, L’Âge d’Homme.
– Oubrou, Tareq (2016), Ce que vous ne savez pas sur l’islam, Fayard.
– Picaudou, Nadine (2010), L’Islam entre religion et idéologie. Essai sur la modernité musulmane, Gallimard.
– Reichmuth, Stefan (2009), The World of Murtada al-Zabidi, 1732-91 : Life, Networks and Writings, Gibb Memorial Trust.
– Riffi, Daoud (2019), « Comprendre le salafisme », Les Cahiers de l’Islam, mai 2019 (consultable en ligne).
– Riffi, Daoud (2020), « Wahhabisme », in « Les Mots de l’islam », Orient XXI, mai 2020 (consultable en ligne).
– Turki, Abdel-Magid (2002) « Aggiornamento juridique: continuité et créativité ou fiction de la fermeture de la porte de l’Ijtihâd? », Studia Islamica, No. 94, pp. 5-65.