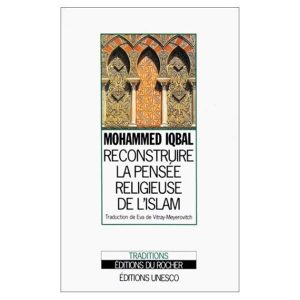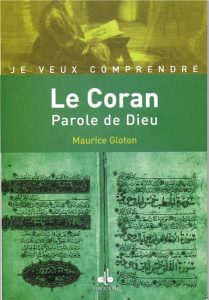Mizane.info publie la première partie d’un texte de Mouhib Jaroui consacré au questionnement des relations entre philosophie islamique et sécularisation. Quels rapports l’islam et la philosophie ont-ils entretenu au cours de son histoire intellectuelle ? Pour y répondre, l’auteur va s’appuyer sur trois figures paradigmatiques : le penseur et poète pakistanais Muhammad Iqbal, le célèbre philosophe andalou Ibn Rushd (Averroès) et le moins connu Mostapha Abderraziq.
La philosophie religieuse est une bonne illustration de la question du renouveau dans la pensée musulmane contemporaine.
Elle constitue ici un bel atelier pour étudier la manière dont se déploie la problématique liée au couple authenticité/renouveau.
Donc, ce n’est pas tant le contenu philosophique de telle ou de telle autre doctrine qui nous intéresse que les lectures contemporaines de la tradition philosophique musulmane.
Comme le dit Iqbal dans un ouvrage qui souhaite, dit-il, reconsidérer la philosophie religieuse musulmane, « nous devons nous rappeler qu’il n’y a rien de définitif dans la réflexion philosophique »[1], et à partir de là il interroge l’authenticité de la philosophie musulmane.
La renaissance européenne qui a eu lieu aux alentours du XVIe siècle s’est appuyée sur l’héritage de l’antiquité, dont la philosophie grecque, qu’elle soit présocratique, platonicienne ou aristotélicienne.
Or celle-ci, n’est pas parvenue directement à l’Europe, elle avait été transmise par l’intermédiaire notamment des traductions des traités de la philosophie arabe et musulmane.
En effet, al-Kindî, al-Farâbî, Ibn Sînâ, al-Ghazâlî et Ibn Rushd étaient de grands connaisseurs de la philosophie grecque, dont la logique et la métaphysique d’Aristote.

Al-Farâbî tient son surnom de « second maître » pour ses commentaires de la logique d’Aristote qui est considéré comme le premier maître, et on sait à quel point Ibn Sînâ est redevable au « seconde maître » de son commentaire de la métaphysique d’Aristote.
Avant de traiter plus explicitement de la question de l’authenticité de cette philosophie, on peut s’interroger sur les raisons qui ont poussé ces penseurs musulmans à consacrer tant d’efforts à la lecture, à la compréhension et à l’intégration de la philosophie grecque dans leurs traités.
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre avec exactitude, mais des hypothèses plausibles sont envisageables :
1. Le Coran incite à la philosophie, à la méditation sur le cosmos et l’homme, c’est pourquoi ils n’y ont vu aucun mal à s’ouvrir sur les autres philosophies existantes.
2. La philosophie grecque traitait de théologie qui permettait aux musulmans de prendre position assez aisément soit en y souscrivant car elle leur permettait de mieux comprendre les enseignements islamiques, soit en l’adaptant ou en l’ajustant à leur propre théologie. En effet, de même que les fondements de la religion (uçûl ad-dîne) exprimaient un certain rapport entre la raison et la ‘Aquîda, les fondements du droit musulman exprimaient eux aussi un certain rapport entre la raison et la Législation. Songeons à l’éternelle dialectique entre « al-‘aql wa an-naql » qui traverse les différentes sciences islamiques.
3. La philosophie grecque offrait un ensemble d’outils et de concepts jugés pertinents et qui permettaient aux penseurs musulmans d’enrichir leur propre réflexion, de la mettre en système tout en respectant tant bien que mal leur doctrine musulmane.
Selon Muhsin Mahdi, « une tradition religieuse est également susceptible d’interprétations et cela d’une façon qui pourrait affecter son for intérieur en permettant de concilier avec des conceptions philosophiques ou de justifier celles-ci au regard de la tradition religieuse.
La philosophie grecque qui a élargi les horizons de la pensée rationnelle chez les penseurs musulmans les a détournés en même temps de la méditation du Coran. La preuve en est que Socrate concentre son attention sur l’homme uniquement, excluant par exemple le monde des plantes, des insectes et des astres, et cette vision est contraire à l’esprit de l’islam qui voit en la simple abeille une source possible d’inspiration divine. Iqbal
On ne peut se contenter par exemple de supposer qu’Alfarabi, réfléchissant sur l’islam en gardant à l’esprit La République et les Lois de Platon, et Thomas d’Aquin, réfléchissant sur le christianisme avec La politique et l’Ethique à Nicomaque d’Aristote en tête, restent confinés dans un cercle dont le centre immuable serait la foi ou la croyance religieuse.
Il est plutôt assuré que le manière dont la foi ou la croyance est formulée au sein de pareille approche n’est plus la vision pré-philosophique de la foi ou de la croyance, mais le résultat d’un processus complexe et d’interprétation »[2].
Tant bien que mal, disions-nous, car les résultats ont semblé parfois « hérétiques » à certains théologiens musulmans.
Songeons à al-Ghazâlî qui a jeté l’anathème sur les premiers philosophes autour de questions proprement théologiques, comme la pérennité du monde, la réincarnation des corps et la connaissance des étants particuliers par Dieu.
Si les raisons de l’articulation de la philosophie grecque à la foi musulmane semblent évidentes et compréhensibles, l’authenticité du syncrétisme qui en a résulté est, elle, très discutée jusqu’à nos jours.
Cette inspiration de la philosophie grecque a été jalonnée durant les siècles suivants tantôt par des acceptations, tantôt par des rejets, provoquant des débats.
Des philosophes de la période contemporaine, préoccupés par la question du renouveau, ont considéré que la nature même de la philosophie grecque est incompatible avec la philosophie de l’islam.
C’est le cas par exemple de Mohammed Iqbâl qui s’est intéressé à la question du renouveau.
Il est d’abord important de citer la première phrase de son livre qui porte sur le renouveau de la pensée religieuse et qui nous permet de comprendre pourquoi la philosophie grecque est à ses yeux contraire à l’esprit de l’islam : « Le Coran confirme l’importance de l’action, de la pratique, bien plus que la pensée »[3].
Or la philosophie grecque s’est focalisée sur le monde de l’intellect bien plus que sur l’univers dans sa globalité :
« La philosophie grecque – comme nous le savons tous – était une autorité puissante dans l’histoire de l’islam, et malgré cela, si nous méditons le Coran, mais aussi les différentes écoles du kalam qui sont apparues sous l’influence de cette philosophie, alors nous apparaît une vérité qui suscite intérêt. La philosophie grecque qui a élargi les horizons de la pensée rationnelle chez les penseurs musulmans les a détournés en même temps de la méditation du Coran. La preuve en est que Socrate concentre son attention sur l’homme uniquement, excluant par exemple le monde des plantes, des insectes et des astres, et cette vision est contraire à l’esprit de l’islam qui voit en la simple abeille une source possible d’inspiration divine (comme le stipule le Coran) »[4].
La même critique est adressée à Platon qui, selon Iqbal, « dénigre la perception sensible sous prétexte qu’elle produit la conjecture et non la connaissance certaine, et cela est fort éloigné du Coran qui considère que l’ouïe et la vision sont parmi les plus grands bienfaits de Dieu ».
Pour Iqbal, le monde des idées et le réel ne sont pas des forces contraires et inconciliables, la vie des idées ne se réalise pas complètement en se séparant du réel.
Il récuse aussi cette séparation étrangère à l’islam qui consiste à scinder l’ésotérique (le dedans) de l’exotérique (le dehors).
L’islam a dépassé cette dichotomie et confirme l’interdépendance du monde des idées et le monde matériel.
C’est pourquoi, selon Iqbal, l’islam est venu confirmer la nécessité de l’expérience réaliste bien avant que la science moderne ne se l’approprie.
« L’esprit du Coran penche vers ce qui est réel, tangible, alors que la nature de la philosophie grecque est contemplative, abstraite, se concentre sur la théorie et occulte le réel »[5].
C’est bien cette « pensée classique » qui est dans une certaine mesure responsable selon lui de ce « manquement des premiers lecteurs du Coran, car ils l’ont lu à la lumière de la pensée grecque ».
Cela dit, tout n’était pas perdu, car il a fallu attendre plus de deux siècles pour que l’on comprenne que « l’esprit du Coran est dans son essence en contradiction avec la pensée classique »[6].
Au regard de ces avis iqbaliens sur la « pensée classique », on ne doit pas s’étonner de voir Ibn Rushd, « le défenseur de la philosophie grecque » faire l’objet de la même critique, donnant raison aux Ash’arites contre lui, avec quelques réserves cependant sur la pensée de Ghazâlî qui n’aurait pas compris lui aussi, comme Emmanuel Kant, les possibilités infinies de l’intellect[7].
La tradition Averroïste entre authenticité et modernité
L’œuvre d’Ibn Rushd, le « commentateur d’Aristote », mérite ici notre plus grande attention pour les lectures plurielles et parfois opposées qu’elle suscite dans la pensée musulmane d’aujourd’hui, mais qui ont pour point commun de tenter d’élucider le problème de l’authenticité/contemporanéité à travers l’insidieuse question de la sécularisation.
Pour ce faire, nous prendrons en exemple des auteurs qui font autorité et sont donc incontournables dans la champ philosophique contemporain.
Ainsi, selon ‘Âtif al-‘Irâqî « nous nous déshonorons lorsqu’on néglige la tradition d’Ibn Rushd (« Turâth Ibn Rushd ») le doyen de la philosophie rationnelle ; tradition à partir de laquelle nous devons commencer pour résoudre la question de l’authenticité et la contemporanéité »[8].
Avec beaucoup d’insistance, le penseur égyptien pense que si l’on veut résoudre le problème de « la tradition, l’authenticité, la contemporanéité et le renouveau, et notre positionnement par rapport à la civilisation occidentale (…), nous devons alors retourner à la tradition du philosophe Ibn Rushd »[9].
Quant aux philosophes, ils s’attachent à la connaissance des êtres en faisant usage de leur intellect, sans s’appuyer sur les discours qui l’y invitent à y adhérer sans démonstration. Ibn Rushd
La lecture de ‘Atif al-‘Irâqî est très instructive en ceci qu’avec d’autres penseurs contemporains elle propose une lecture sécularisatrice du philosophe Andalou, y compris de la philosophie musulmane dans son ensemble.
Il est en effet hostile à l’appellation de « philosophie musulmane » lui préférant « la philosophie arabe » (c’est d’ailleurs le titre de l’un de ses ouvrages).
Pour lui, « notre grand philosophe, Ibn Rushd, nous a appelés à distinguer le domaine de la religion de celui de la philosophie » et ne pas mélanger les deux champs.
« On peut déjà être fier de notre philosophe car sa philosophie ne s’est pas limitée à la relation entre la religion et la philosophie, comme s’il avait compris qu’il devait méditer la philosophie en elle-même, en dehors de la question de la relation entre religion et philosophie »[10].
Et pour accentuer cette séparation entre l’arabité et l’islamité du philosophe andalou, il ira jusqu’à affirmer avec assurance que si l’on souhaite comprendre sa philosophie, il ne faut pas se limiter à ses œuvres personnelles, mais étudier ses commentaires d’Aristote.
Il pense même qu’on a accordé trop d’importance à la question de la concordance entre religion et philosophie qui n’est qu’une « question contingente », on aurait selon lui surestimé les ouvrages « Façl al-maqâl » et « Manâhij al-adilla », deux écrits qui traitent de cette question de conciliation entre les deux domaines bien distincts.
A certains égards, ‘Âtif Al-Irâqî affirme que les « commentaires d’Aristote réalisés par Ibn Rushd sont bien plus importants que ses propres écrits ».[11]
Mais alors que retenir de la philosophie d’Ibn Rushd ? Comment la comprendre ?
Pour ‘Âtif al-‘Irâqî « on peut dire que la clé de la philosophie d’Ibn Rushd dans son ensemble réside dans cette séparation essentielle entre ces trois ordres, rhétorique, dialectique et démonstration »[12].
Selon lui, la position critique d’Ibn Rushd envers le kalam ou la scolastique musulmane, s’explique par son attachement ferme au Borhân (la démonstration) et sa prééminence par rapport à la dialectique et à la rhétorique, c’est-à-dire par rapport aux preuves persuasives.
Et on sait qu’Ibn Rushd, comme beaucoup d’autres philosophes arabes, ont été influencés par la logique dialectique et démonstrative d’Aristote.

A partir de là, les philosophes arabes ont considéré les praticiens du kalam comme les représentants de la pensée dialectique, cependant que les philosophes représentent la pensée démonstrative (al-Borhân) :
« Quant aux philosophes, nous dit Ibn Rushd, ils s’attachent à la connaissance des êtres en faisant usage de leur intellect, sans s’appuyer sur les discours qui l’y invitent à y adhérer sans démonstration »[13].
Ibn Rushd fut alors soucieux de distinguer les discours rhétorique, dialectique et démonstratif en recherchant ce dernier car plus à même d’atteindre la connaissance certaine.
Mais ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas tant sa philosophie que la lecture de la tradition philosophique qu’il nous a léguée et, par voie de conséquence, la compréhension contemporaine de la relation entre le monde visible et le monde invisible.
Il est lu en tant qu’il est constitutif de la tradition ou du patrimoine arabe et/ou musulman, bien plus, il est lu en tant qu’il est une grille de lecture du « progrès » et du « sous-développement » :
« Il a publié ce qu’il a écrit afin que nous profitions de lui, nous les arabes, non pour que son patrimoine soit négligé et tombe dans l’oubli. L’Europe a connu le progrès car elle a pris Ibn Rushd comme modèle à travers un fort mouvement averroïste, quant à nous les arabes, nous avons connu le retard car le modèle chez nous se résumait à des penseurs traditionalistes de la sclérose, comme al-Ghazâlî, les Ash’arites et Ibn Taymiyya »[14].
Nous avons là une parfaite illustration de la mobilisation de la tradition comme facteur déterminant et explicatif du réel vécu, du monde contemporain.
Quant aux Mutakallimûn dialecticiens, à l’inverse, ils partent des fondements respectifs relatifs à « l’invisible », c’est-à-dire au monde divin et établissent le « visible », c’est-à-dire les données du sensible, de sorte à prouver leurs fondements. Jabri
Même lecture de la tradition averroïste chez Mohammed ‘Âbed al-Jâbirî qui met l’accent sur la séparation des deux sphères, la philosophie et la religion, et voit dans « Façl al-maqâl » une séparation nette entre le monde visible et le monde invisible.
Pour lui le rushdisme a ouvert des « horizons nouveaux, toutefois transmis en Europe, puisque le rushdisme est mort-né dans le monde arabe »[15].
Cette lecture garde à l’esprit ce souci de faire de la culture intellectuelle arabe une pensée à la fois « authentique et contemporaine »[16].
Selon lui, Ibn Rushd n’a jamais voulu concilier religion et philosophie[17], comme le souhaitaient les premiers philosophes musulmans, mais au contraire séparer les deux ordres et montrer qu’ils ont des méthodes bien distinctes.
Ses ouvrages « Façl al-maqâl » et « Manâhij al-adilla » sont à cet effet une objection contre les gens du Kalam, du Fiqh et du Soufisme.
Par exemple, à propos du soufisme, il note son manque d’objectivité : « Quant aux soufis, leurs méthodes de recherche ne sont pas discursives, c’est-à-dire composées de prémisses et de syllogismes. Mais ils prétendent que la connaissance de Dieu et des autres êtres est quelque chose jetée dans l’âme, lorsque celle-ci se libère des assauts de la concupiscence et qu’elle se porte mentalement vers l’objet de sa quête (…). Mais nous, nous disons que cette voie, même si l’on en admet l’authenticité, ne saurait s’imposer au commun des mortels »[18].
C’est ainsi qu’al-Jâbirî comprend Ibn Rushd qui selon lui « commence de façon méthodique par une « réforme de la ‘aquida », à savoir la séparation entre religion et la science (à son époque une branche de la philosophie).
La science a pour but de penser les étants en les comprenant d’abord tels qu’ils sont, et ensuite en déduire le sens.
La primauté revient à la « science » par rapport à la « pratique » (pratique au sens de comportement religieux et moral).
Quant à la religion, son but premier est la pratique, et la science religieuse est dédiée à la pratique »[19].
Cette séparation est encore plus visible à travers les arguments avancés lorsque le philosophe Andalou s’attaque aux praticiens du kalam, ach’arites comme mu’tazilites.
Voici la lecture de la tradition Averroïste d’al-Jâbirî : « Quant à la différence entre les savants et les mutakallimîn, les dialecticiens, c’est que les savants – à savoir les philosophes – partent du « visible », c’est-à-dire des données du sensible et de l’expérience, et s’élèvent ensuite vers « l’invisible » ou la « métaphysique », c’est-à-dire le monde divin. Ils cherchent la certitude en posant des prémisses et en suivant des étapes logiques. Leur but est d’atteindre la vérité et de fonder la science pour la science (…). Quant aux mutakallimûn dialecticiens, à l’inverse, ils partent des fondements respectifs relatifs à « l’invisible », c’est-à-dire au monde divin et établissent le « visible », c’est-à-dire les données du sensible, de sorte à prouver leurs fondements. Leur objectif, donc, est de gagner des partisans sous leur bannière et non de fonder la science »[20].
Ces propos liminaires sont indispensables du point de vue d’al-Jâbirî pour comprendre les objections d’Ibn Rushd adressées à al-Ghazâlî et Ibn Sînâ.

Pour Ibn Rushd, le théologien Ash’arite s’est trompé de cible lorsqu’il s’est attaqué à la philosophie à travers les premiers philosophes musulmans – comme Ibn Sînâ – en prétendant les réfuter avec leur propre langage : la logique aristotélicienne.
En effet, ayant trahi la raison démonstrative au sens aristotélicien du terme, Ibn Sînâ a davantage adopté la méthode du kalam que celle du borhân (démonstration), et ne peut donc être considéré comme philosophe au sens plein du terme.
Ce qui explique les critiques parfois acerbes d’Ibn Rushd à l’encontre d’Ibn Sînâ. Et al-Ghazâlî, plus soucieux de défendre le Ash’arisme que la science, n’a pas compris qu’ibn Sînâ ne s’était pas attaqué au kalam de son époque (Ash’arite) en tant que péripatéticien, il était très loin de la démonstration syllogistique.
Preuve en est que les philosophes grecs, dont Aristote, ne s’étaient pas souciés de ces questions dans une perspective théologique ou scolastique, comme la pérennité du monde, la réincarnation des corps et la connaissance des étants particuliers par Dieu.
C’est donc la « confusion » des genres qui expliquerait cette polémique lancée par le ash’arite al-Ghazâlî à l’encontre de la philosophie.
Se rangeant du côté d’Ibn Rushd et en mettant l’accent sur la séparation entre religion et philosophie (au sens de raison démonstrative et scientifique), al-Jabirî entérine la lecture sécularisatrice du patrimoine philosophique musulman.

La thèse d’Ibn Rushd, telle qu’elle est lue par al-Jâbirî, est aujourd’hui confirmée par des philosophes contemporains, comme nous venons de le voir avec ‘Âtif al-Îrâqî, mais aussi dans une autre perspective et indirectement par Mohammed Abou Rayâne.
Pour ce spécialiste de la philosophie musulmane, al-Kindî, al-Farâbî et Ibn Sînâ étaient bien plus proches de la philosophie de Platon et du néo-platonisme que de l’école péripatéticienne.
C’est la position qu’il défend lors de son intervention, en 1989, au colloque « Autour d’une philosophie islamique contemporaine » organisé par l’institut international de la pensée islamique.
Son intervention portait sur une « Nouvelle méthode pour l’étude de la philosophie islamique ».
Il fait le constat que « la prétendue philosophie péripatéticienne islamique puise en réalité son architecture globale dans la théorie de l’émanation (al-faydh) platonicienne, et commence par al-Kindî, en passant par al-Farâbî et Ibn Sînâ. Or, la théorie des dix intellects [centrale dans la théorie de l’émanation] est ce qui fait la force de l’école dite péripatéticienne islamique en métaphysique »[21].
Par exemple, on sait les efforts d’al-Fârâbî pour concilier les philosophies respectives de Platon et d’Aristote, et les propos sévères qu’Ibn Sinâ a tenus à l’encontre des péripatéticiens leur préférant sa « sagesse ishrâqiyya » emprunte de soufisme.
Notons que bien d’autres travaux confirment l’influence de l’école d’Alexandrie sur la philosophie d’al-Farabi, c’est la conclusion de Philippe Vallat dans son enquête bien documentée :
« Il apparait maintenant que non seulement Farabi s’inscrit à la suite des philosophes alexandrins, mais qu’il les prolonge tout en se rattachant directement à leur source d’autorité commune, à savoir Platon »[22].
Mouhib Jaroui
Notes
[1] Mohammed Iqbâl, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p.11.
[2] Muhsin Mahdi, La cité vertueuse d’Alfarabi. La fondation de la philosophie politique en Islam, 2000, p.56.
[3] Mohammed Iqbâl, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p. 9.
[4] Mohammed Iqbâl, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p. 17.
[5] Mohammed Iqbal, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p. 211.
[6] Mohammed Iqbâl, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p. 18.
[7] Mohammed Iqbâl, Tajdîd al-fikr ad-dînî fî al-islâm, p. 19.
[8] ‘Âtif al-‘Irâqî, Le philosophe Ibn Rushd et l’avenir de la culture arabe. Quarante ans de mes souvenirs de sa pensée des Lumières, 2000, p. 46.
[9] ‘Âtif al-‘Irâqî, Le philosophe Ibn Rushd et l’avenir de la culture arabe. Quarante ans de mes souvenirs de sa pensée des Lumières, 2000, p. 60.
[10] ‘Âtif al-‘Irâqî, Le philosophe Ibn Rushd et l’avenir de la culture arabe. Quarante ans de mes souvenirs de sa pensée des Lumières, 2000, p. 61
[11] ‘Âtif al-‘Irâqî, Le philosophe Ibn Rushd et l’avenir de la culture arabe. Quarante ans de mes souvenirs de sa pensée des Lumières, 2000, p. 52.
[12] ‘Âtif al-‘Irâqî, al-manhaj an-naqdî fî falsafat Ibn Rushd, 1984, 2ème éd. p. 47.
[13] Averroès, L’islam et la raison, p. 173.
[14] ‘Âtif al-‘Irâqî, Le philosophe Ibn Rushd et l’avenir de la culture arabe. Quarante ans de mes souvenirs de sa pensée des Lumières, 2000, p. 44-45.
[15] Mohammed ‘Âbed al-Jabirî, Takwîne al-‘aql al-‘arabî, 1984, p.323.
[16] Mohammed ‘Âbed al-Jâbirî, Nahnu wa at-Turâth, qirâât mo’âçira fî turathinâ al-falsafî, p. 321.
[17] Il est intéressant de voir que cette question se pose également chez les chrétiens, lire Étienne Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, chapitre 2, « la notion de philosophie chrétienne », 1944, p. 17.
[18] Averroès, L’islam et la raison, p. 107-108.
[19] Mohammed ‘Âbed al-Jâbirî, Ibn Rushd, Sîra wa Fikr, dirâssa wa noçûç. Markaz dirâssât al-wahda al-‘arabiyya, 1998, 2ème éd. 2001, p. 113.
[20] Mohammed ‘Âbed al-Jâbirî, Ibn Rushd, Sîrah wa Fikr, dirâssa wa noçûç. Markaz dirâssât al-wahda al-‘arabiyya, 1998, 2ème éd. 2001, p. 117.
[21] Mohammed Abou Rayâne, Pour une philosophie islamique contemporaine, IIIT, 1994, p. 229.
[22] Philippe Vallat, Farabi et l’Ecole d’Alexandrie. Des prémisses de la connaissance à la philosophie politique, Etudes musulmanes, 2004, p. 367.